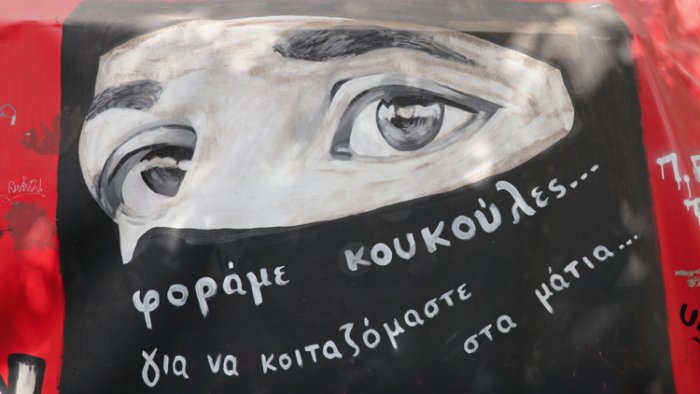Série : Le témoignage de Yanis Varoufakis : accablant pour lui-même
Varoufakis-Tsipras vers l’accord funeste avec l’Eurogroupe du 20 février 2015
Partie 6 11 février par Eric Toussaint
Avertissement : La série d’articles que je consacre au livre de Varoufakis, Conversations entre Adultes, constitue un guide pour des lecteurs et des lectrices de gauche qui ne souhaitent pas se contenter de la narration dominante donnée par les grands médias et les gouvernements de la Troïka ; des lecteurs et des lectrices qui ne se satisfont pas non plus de la version donnée par l’ex-ministre des Finances |1|. En contrepoint du récit de Varoufakis j’indique des évènements qu’il passe sous silence et j’exprime un avis différent du sien sur ce qu’il aurait fallu faire et sur ce qu’il a fait. Mon récit ne se substitue pas au sien, il se lit en parallèle.
Il est essentiel de prendre le temps d’analyser la politique mise en pratique par Varoufakis et le gouvernement Tsipras car, pour la première fois au 21e siècle, un gouvernement de gauche radicale a été élu en Europe. Comprendre les failles et tirer les leçons de la manière dont celui-ci a affronté les problèmes qu’il rencontrait sont de la plus haute importance si on veut avoir une chance de ne pas aboutir à un nouveau fiasco.
L’enjeu de la critique de la politique qui a été suivie par le gouvernement grec en 2015 ne consiste pas principalement à déterminer les responsabilités respectives de Tsipras ou de Varoufakis en tant qu’individus. Ce qui est fondamental, c’est de réaliser une analyse de l’orientation politico-économique qui a été mise en pratique afin de déterminer les causes de l’échec, de voir ce qui aurait pu être tenté à la place et d’en tirer des leçons sur ce qu’un gouvernement de gauche radicale peut faire dans un pays de la périphérie de la zone euro.
Dans les jours et les semaines qui suivent l’agression de la BCE contre la Grèce, le 4 février 2015, se déroulent d’intenses négociations qui amènent à l’accord funeste du 20 février, confirmé le 24 février. Par cet accord qui prolongeait de quatre mois le deuxième mémorandum rejeté par la population grecque, le gouvernement d’Alexis Tsipras s’est engagé à rembourser tous les créanciers selon le calendrier prévu (pour un total de 7 milliards € entre février et fin juin 2015, dont 5 milliards au FMI) et à soumettre à l’Eurogroupe de nouvelles mesures d’austérité et de privatisations.
Nous allons suivre et analyser le film des évènements dans cette partie. La narration par Varoufakis des négociations avec l’Eurogroupe mérite d’être connue et je vous encourage à la lire en entier.
Le 5 février 2015, Yanis Varoufakis, accompagné d’Euclide Tsakalotos, est à Berlin afin de rencontrer d’une part Wolfgang Schäuble |2|, son homologue allemand, et d’autre part Sigmar Gabriel, vice-chancelier et ministre fédéral de l’Économie dans le cadre de la grande coalition entre la CDU-CSU d’Angela Merkel et le SPD.
Le contact avec Schäuble commence mal car celui-ci refuse de lui serrer la main. Varoufakis met en avant les deux points suivants : « Premier point, je ne demandais pas de radiation de la dette, et l’échange de dettes que je proposais bénéficierait à l’Allemagne et à la Grèce. Deuxième point, j’ai insisté sur ma détermination à traquer les fraudeurs et faire passer des réformes pour encourager l’entreprenariat, la créativité et la probité dans la société grecque » |3|.
Varoufakis explique que la relation s’est détendue, Schäuble lui proposant de se tutoyer et de lui envoyer cinq cents inspecteurs du fisc allemand. « Je l’ai remercié pour sa générosité, mais j’avais peur qu’ils se découragent en réalisant qu’ils ne pouvaient déchiffrer ni les déclarations de revenus ni les papiers nécessaires. En revanche j’avais une idée : et s’il nommait le secrétaire général de l’administration fiscale de mon ministère ? » |4|
Varoufakis précise qu’il s’agissait de sa part d’une proposition tout à fait sérieuse. Il en a profité pour expliquer à Schäuble quelque chose que le ministre allemand savait certainement déjà : à savoir qu’au sein du ministère grec des Finances, le service de collecte des impôts avait été confié à une personne du privé. Varoufakis explique : « la personne qui en était responsable n’était ni nommée par moi ni redevable devant moi ou mon Parlement, même si c’était à moi de rendre compte de son action quotidienne. Voilà donc ce que je lui proposais : il choisirait un administrateur fiscal allemand aux références irréprochables et à la réputation intacte qui serait nommé sur-le-champ et responsable devant lui et moi ; si il ou elle avait besoin de renfort de son ministère, je n’y voyais aucun inconvénient. » Sur ce point, Varoufakis propose une solution qui constituerait, si elle était appliquée, un abandon encore plus important de souveraineté, et cela directement au profit du gouvernement allemand.
Mais Schäuble n’était pas intéressé et passe au sujet qui est au cœur de toute sa stratégie et de ses motivations profondes : « sa théorie suivant laquelle le modèle social européen « trop généreux » était intenable et bon à jeter aux orties. Comparant le coût du maintien des États-providences avec ce qu’il se passe en Inde ou en Chine, où il n’y a aucune protection sociale, il estimait que l’Europe perdait en compétitivité et était vouée à stagner si on ne sabrait pas massivement dans les prestations sociales. Sous-entendu, il fallait bien commencer quelque part, et ce quelque part pouvait être la Grèce. » |5|
Si Varoufakis, Tsakalotos et le cercle dirigeant autour de Tsipras avaient pris au sérieux le message que voulait faire passer Schäuble et que son homologue italien avait déjà transmis à Varoufakis deux jours plus tôt, lors de son passage à Rome, ils auraient compris que la proposition d’échanges de dettes n’avait aucune chance de convaincre le gouvernement allemand et tous les gouvernements de la zone euro qui font de l’augmentation de la compétitivité (au profit des grandes entreprises privées exportatrices) leur objectif principal |6|. L’enjeu central pour eux est de baisser, partout en Europe, les salaires, les retraites et les allocations sociales, de précariser les contrats, limiter le droit de grève, réduire les dépenses sociales dans les dépenses de l’État, privatiser, etc. Si la proposition de Varoufakis avait été acceptée, elle aurait permis au gouvernement grec de desserrer l’étau de la dette. Or, le gouvernement allemand et la plupart des autres gouvernements de la zone euro (sinon tous) ont besoin de l’étau de la dette pour imposer la poursuite de l’application de leur modèle et se rapprocher des objectifs qu’ils se sont fixés. Ils souhaitaient aussi ardemment faire échouer le projet de Syriza afin de démontrer aux peuples des autres pays qu’il est vain de porter au gouvernement des forces qui prétendent rompre avec l’austérité et le modèle néolibéral.
Pour imposer des reculs sociaux, les dirigeants européens disposent également de la monnaie unique, l’euro, car elle permet d’imposer ce qu’on appelle la dévaluation interne |7| qui consiste principalement à réduire les salaires.
Syriza n’avait pas demandé à ses électeurs de lui donner un mandat pour sortir de la zone euro, par contre le gouvernement de Tsipras avait un mandat très clair pour agir afin d’effacer la majeure partie de la dette publique. Donc il était fondamental de donner la priorité à cet objectif. Varoufakis et le noyau dirigeant autour de Tsipras ont décidé de contourner ou d’abandonner tout de suite cet objectif.
Avant que l’entretien ne se termine, Varoufakis prend le temps de présenter ses arguments en faveur d’un échange de dette et remet à Schäuble la proposition écrite qu’il a déjà défendue à Paris, Londres, Rome et Francfort. Selon Varoufakis, Schäuble n’a pas daigné jeter un œil sur son document. Il l’a automatiquement donné à un de ses Secrétaires d’État en l’informant que c’était pour les « institutions » de la Troïka.
Ensuite, ils ont donné ensemble une conférence de presse. Schäuble, écartant la possibilité d’un terrain d’entente, a déclaré tout de go : « Nous sommes d’accord pour dire que nous ne sommes pas d’accord » (p. 220).
Puis, après une boutade, Varoufakis a adopté un ton œcuménique : « Je suis d’abord venu voir un homme d’État européen pour qui l’unité de l’Europe est un projet de longue date, un homme dont je suis avec intérêt les efforts et le travail au service de cette unité depuis les années 1980. » Au cours de son intervention il a précisé : « Quant aux défis de l’UE en général, je lui ai proposé de respecter les traités et les procédures existants sans attenter au fragile bourgeon de la démocratie » (p. 221). Comment peut-on sérieusement imaginer que le respect des traités et des procédures de l’UE est compatible avec l’éclosion du fragile bourgeon de la démocratie ? L’ensemble de l’ouvrage de Varoufakis démontre d’ailleurs que le carcan de l’UE portait atteinte à la démocratie grecque.
Il ne fallait pas invoquer, du côté grec, le respect des traités car cela donnait un argument très fort aux dirigeants européens pour exiger leur application par Athènes. C’était à éviter absolument car les deux mémorandums signés par la Grèce en 2010 et en 2012 avaient valeur de traités internationaux.
Il faut signaler encore que selon Varoufakis, lors de la conférence de presse, un journaliste allemand lui a demandé si, en tant que ministre, il allait rappeler à Schäuble que le gouvernement allemand était tenu d’extrader vers la Grèce Michael Christoforakos, l’ancien dirigeant de la filiale grecque de Siemens.
Il était avéré que Michael Christoforakos avait soudoyé, pour le compte de Siemens, des politiciens grecs en vue d’obtenir des contrats d’État. Les autorités grecques avaient tenté de l’arrêter, mais Christoforakos s’était enfui en Allemagne où il avait été arrêté. Depuis, les tribunaux allemands refusent de l’extrader vers la Grèce.
Varoufakis explique qu’il était scandalisé par le fait que les autorités allemandes refusent de remettre Christoforakos à la justice grecque mais qu’il ne pouvait pas l’exprimer comme cela lors d’une conférence de presse |8|. Dès lors, il a répondu au journaliste : « Je suis sûr que les autorités allemandes sauront aider un État fragilisé à se battre contre la corruption. Je compte sur mes collègues allemands pour comprendre qu’il n’est pas question d’avoir deux poids deux mesures où que ce soit en Europe » (p. 222-223).
Le rendez-vous qui a suivi avec Sigmar Gabriel, vice-chancelier, ministre de l’Économie et dirigeant SPD, fait penser à la rencontre avec Michel Sapin qui avait eu lieu le 1er février (voir la partie 5). Gabriel lui déclare qu’il fait cause commune avec le gouvernement de Syriza, puis tient un tout autre discours devant la presse. « Je n’avais droit qu’à des remarques agressives sur mon gouvernement et une interprétation rigoriste des obligations vis-à-vis de nos bailleurs de fonds. Cerise sur le gâteau, Gabriel a même osé parler de la « souplesse » de la troïka » (p. 225).
En réponse : « j’ai tranquillement servi mon baratin sur notre détermination à trouver un équilibre durable grâce à des propositions raisonnables pour revoir le plan de la troïka qui était un échec… » (p. 225).
De retour à Athènes
6 février. À partir du 6 février, Varoufakis se met au travail avec ses collaborateurs (pour une présentation de l’équipe dont Varoufakis s’était entouré, voir Varoufakis s’est entouré de tenants de l’ordre dominant comme conseillers) pour préparer la première réunion de l’Eurogroupe à laquelle le gouvernement de Tsipras était invité et qui se tiendrait à Bruxelles le 11 février. « Pendant trois jours et trois nuits, le cinquième étage du ministère a été un va-et-vient incessant d’envoyés de Lazard, de mes associés les plus proches, notamment Glenn Kim et Elena Panaritis » (p. 227). James Galbraith qui venait d’arriver des États-Unis s’est joint à cette équipe.
Simultanément, Varoufakis s’immerge dans l’activité parlementaire et participe à la première réunion du gouvernement au complet. Le 6 février, il se rend au parlement afin de participer comme député à l’élection de la nouvelle présidente du parlement. « L’élection de Zoe Konstantopoulou, députée Syriza intransigeante, au poste de Présidente du Parlement était un symbole. Au cours des deux législatures précédentes, c’est elle qui avait démontré que les méthodes employées pour faire voter les lois imposées par la troïka violaient les procédures usuelles. J’avais été heureux de voter pour elle parce que c’était un signal : plus jamais le Parlement ne serait réduit à donner son blanc-seing à sa propre servitude » (p. 229).
C’est la seule fois où le nom de Zoé Konstantopoulou est mentionné dans le livre de Varoufakis, qui fait plus de 500 pages. À aucun moment, Varoufakis ne fait mention de la création et du travail de la commission d’audit de la dette grecque alors qu’il s’est rendu à sa séance inaugurale le 4 avril 2015 (Voir aussi Chronique des interventions de l’exécutif grec au Comité d’audit de la dette grecque et Acte officiel de création de la Commission de la Vérité sur la Dette publique). Il ne mentionne pas non plus la commission sur les réparations de guerre réclamées à l’Allemagne par la Grèce. Alors que Zoé Konstantopoulou a déployé une intense activité, qu’elle a essayé de contribuer à redonner du sens à l’activité parlementaire, qu’elle a pris part à des discussions publiques et internes concernant les choix à faire, il n’en dit rien.
C’est également tout à fait frappant qu’il ne mentionne qu’une fois dans son livre le nom et l’action de sa vice-ministre, Nadia Valavani, qui était en charge notamment de l’important dossier des dettes fiscales à l’égard de l’État. Nadia Valavani est une figure de premier plan de la résistance à la dictature des colonels, elle a payé de sa personne son engagement. En tant que vice-ministre, elle a accompli un énorme labeur |9|. Alors qu’une personne comme Elena Panaritis est mentionnée plus d’une quarantaine de fois par Varoufakis, Valavani n’a droit qu’à une mention à propos de la finalisation du projet de loi de réponse à la crise humanitaire.
7 février. Première réunion du gouvernement au grand complet
« Samedi matin, 7 février, j’ai assisté à ma première réunion de Cabinet. » On peut imaginer que Varoufakis parle de la première réunion du gouvernement au grand complet, mais cela n’est pas sûr. Ce n’est qu’une supposition. À propos de cette réunion, il poursuit : « J’avais en tête la fameuse phrase d’Oscar Wilde à propos de la démocratie : « Elle est impraticable, elle est à l’encontre de la nature humaine. C’est pourquoi il vaut la peine de l’appliquer. » Après avoir perdu quelques heures précieuses dans cette réunion très cérémonielle, où trop de gens ont trop longtemps parlé, j’ai foncé au bureau où les conseillers de Lazard et mes associés travaillaient sur les trois non papers [ce sont des documents de travail sans statut officiel. Note de l’auteur] que je comptais emporter à Bruxelles » (p. 231). C’est tout ce que Varoufakis nous dit de cette réunion. Le côté lapidaire de ce commentaire sur la première réunion du gouvernement en dit long sur la façon dont Varoufakis perçoit la manière de faire la politique et sur son dédain ou son incompréhension à l’égard des batailles qu’il faudrait mener à l’intérieur d’un gouvernement, comme dans l’ensemble de la société, si on veut pratiquer la démocratie. Varoufakis s’est cantonné, sans tentative de décloisonnement alors, et sans remise en cause de cette attitude aujourd’hui, dans l’entre-soi du cercle hermétique que Tsipras avait construit autour de lui et auquel il était convoqué quand le prince le jugeait nécessaire.
Lundi 9 février. Varoufakis ne montre pas non plus réellement d’intérêt pour les débats au parlement grec. La seule fois où il en parle d’une manière un tant soit peu développée, c’est lors de la session du Parlement, tenue les lundi 9 et mardi 10 février, où il a présenté et défendu les propositions qu’il ferait au cours de la réunion de l’Eurogroupe qui allait se tenir deux jours plus tard à Bruxelles.
« Demain je serai avec mes collègues de l’Eurogroupe à qui j’affirmerai que nous acceptons le principe de continuité entre les engagements des gouvernements précédents et le mandat du nôtre » (p. 233). C’est inacceptable du point de vue du mandat que les électeurs ont donné au gouvernement lors des élections du 25 janvier. Le programme de Thessalonique qui constituait la référence de Syriza pendant la campagne électorale disait « Nous nous engageons, face au peuple grec, à remplacer dès les premiers jours du nouveau gouvernement – et indépendamment des résultats attendus de notre négociation – le mémorandum par un Plan national de reconstruction » (voir l’encadré sur le programme de Thessalonique dans la partie 5). Si les mots ont un sens, cela veut dire que Tsipras s’engageait comme chef du gouvernement à affirmer à l’Eurogroupe et partout ailleurs que son gouvernement refusait le principe de la continuité des engagements pris par les gouvernements précédents en ce qui concerne les mémorandums. Il ne s’agit pas seulement du sens des mots, mais de l’application effective d’une politique de changement. Varoufakis, en affirmant le principe de la continuité sans faire la moindre exception, enfermait la négociation dans le cadre étroit et coercitif de l’application du mémorandum. Et c’est malheureusement ce qui allait se passer, notamment en raison de ce premier renoncement à appliquer le programme pour lequel Syriza avait été porté au gouvernement.
Il faut lire attentivement le raisonnement de Varoufakis qui conduisait à la capitulation : « Le document qui présentait le plan de la Troïka, ce qu’on appelle un Memorandum of Understanding (MoU), établissait une liste des réformes (austérité étudiée, suppression d’avantages sociaux, privatisations ciblées, changements administratifs et judiciaires et ainsi de suite) auxquelles le gouvernement précédent s’était engagé, ainsi que les conditions (ou conditionnalités, pour le dire comme la troïka) à remplir pour le second prêt de renflouement. Il était impossible de les remplir entièrement puisqu’elles impliquaient une souffrance disproportionnée par rapport aux bénéfices, et 90 % du prêt de renflouement avaient été déboursés avant que nous soyons élus.
Toutefois, en examinant de près ce MoU en 2012, j’avais compris que pas mal de mesures pouvaient être appliquées sans provoquer trop de ravages sociaux. Il était donc stratégique de les accepter, ce qui revenait à 70 % du MoU, en échange de ce que nous exigions, et en refusant les mesures franchement toxiques des 30 % restants » (p. 234). Cette position dans la négociation constituait un abandon de l’engagement du programme de Thessalonique de remplacer le mémorandum par un plan de reconstruction. Il dit avoir déclaré au parlement : « Comme nous sommes des partenaires raisonnables, nous inclurons dans notre agenda de réformes jusqu’à 70 % de mesures du programme existant » (p. 234).
Il précisait, dans cette logique de la soumission, l’annonce suivante : « Au cours des négociations je m’engage à ne faire passer aucune loi qui dévierait de notre objectif : atteindre un minimum d’excédent budgétaire primaire » (p. 233). Cela signifiait que le ministre des Finances s’opposerait à toute loi, aussi bonne et nécessaire soit-elle, si l’impact budgétaire pouvait déboucher sur l’incapacité de dégager un excédent primaire |10|. C’est la dictature de l’excédent primaire qui se poursuit et qui est mortifère. Ce n’est pas théorique, c’est très pratique. Au moment où Varoufakis a dit cela, il savait que les créanciers, à commencer par la BCE, n’avaient pas l’intention de fournir des moyens financiers à la Grèce (comme mentionné plus haut, « 90 % du prêt de renflouement avaient été déboursés avant que nous soyons élus » et Varoufakis savait que la Troïka n’avait pas l’intention de verser les 10 % restants). Or, dans le programme de Thessalonique, la possibilité de dégager un excédent primaire était basée sur le fait que l’argent dû à la Grèce lui serait versé (il s’agissait notamment des 2 milliards de bénéfices de la BCE sur les titres grecs et du solde de ce que la Troïka devait verser à la Grèce dans le cadre du 2e mémorandum qui devait se terminer le 28 février 2015) |11|. Varoufakis savait que ce ne serait pas le cas, ce qui voulait dire en clair que la somme prévue pour combattre la crise humanitaire et relancer l’économie ne serait pas disponible si la Grèce ne s’engageait pas à respecter les engagements antérieurs : rembourser les créanciers (plus de 5 milliards à rembourser avant le 30 juin au FMI) et dégager un excédent primaire. Il s’est bien gardé de l’expliquer aux parlementaires, qui en majorité ne sont pas des économistes, et les a enfumés comme la plupart des ministres des Finances le font régulièrement.
« Ma tactique a soulevé un tollé : les partis classiques m’accusaient de ne pas céder assez à la Troïka, la gauche me fustigeait parce que je cédais trop » (p. 234).
Il concluait son introduction par des paroles fortes, qui allaient en fait s’appliquer très rapidement à la ligne qu’il avait présentée au Parlement en accord avec Tsipras : « Si vous n’envisagez pas de pouvoir quitter la table des négociations, il vaut mieux ne pas vous y asseoir. Si vous ne supportez pas l’idée d’arriver à une impasse, autant vous en tenir au rôle du suppliant qui implore le despote de lui accorder quelques privilèges, mais finit par accepter tout ce que le despote lui donne » (p. 233).
Ce type de déclaration est typique de la démarche de Varoufakis et de Tsipras : adopter une attitude très modérée dans la négociation qui est secrète en multipliant les concessions tout en exprimant de manière répétée des paroles radicales fortes en public. Vu que les médias dominants, la Troïka, les partis grecs de droite, attaquaient Varoufakis et Tsipras comme des irresponsables gauchistes, l’illusion a fonctionné. Leur radicalité et leur volonté de résistance face à la Troïka apparaissaient incontestables |12|.
Dans le résumé de la présentation de sa politique au parlement grec, Varoufakis ne fait allusion à aucun moment à la revendication d’effacement de la majeure partie de la dette inscrite dans le programme de Thessalonique. Cela tranche avec le discours prononcé dans la même enceinte par Zoé Konstantopoulou lors de son élection comme présidente du parlement le 6 février 2015 : « Des initiatives (…) seront entreprises afin que le Parlement contribue de manière essentielle à promouvoir les revendications d’annulation de la majeure partie de la dette et de l’intégration de clauses de croissance et de garanties d’endiguement de la crise humanitaire et de secours à notre peuple. La diplomatie parlementaire n’est pas un cérémonial ni l’équivalent de relations publiques. Elle est un précieux outil qu’il est nécessaire de mettre en branle, pour ce qui est tant du Président que des commissions de relations internationales ou de commissions d’amitié, de sorte que l’affaire grecque, la demande d’une solution équitable et bénéfique pour notre peuple, par annulation de la dette et moratoire des remboursements soit l’objet d’une campagne interparlementaire de revendication vive, qui s’appuie sur l’information de vive voix des autres parlements et assemblées parlementaires mais aussi des peuples européens qui se mobilisent déjà en solidarité de notre peuple » (voir le Discours prononcé par Zoé Konstantopoulou, lors de son élection en tant que Présidente du Parlement hellénique.). La présidente du Parlement grec avait raison d’insister sur la nécessité de déclarer un moratoire sur le remboursement de la dette afin d’obtenir l’effacement de la majeure partie de celle-ci. C’était une condition sine qua non du respect des engagements pris par Syriza et du démarrage des changements promis à la population.
10 février. Varoufakis cherche l’appui de l’OCDE. Le 10 février en soirée, Varoufakis a organisé la réception en grandes pompes d’une délégation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’OCDE). Angel Gurria, son secrétaire général, avait fait le déplacement à Athènes. On peut parfaitement comprendre l’intérêt pour un gouvernement de chercher à rompre la stigmatisation dont il faisait l’objet de la part de la presse internationale dominante et de la Troïka. Mais Varoufakis en remet une couche : « Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés au palais Maximou en grande pompe face aux caméras du monde entier. Le Premier ministre accueillait le Secrétaire général de l’OCDE avec le vice-Premier ministre, Dragasakis, et le ministre de l’Économie, Stathakis, et moi. Une façon de montrer que le gouvernement Syriza travaillerait main dans la main avec le club des pays les plus riches pour soumettre un agenda pro-croissance (…). La contribution d’une institution mondiale aussi prestigieuse, qui adouberait l’agenda une fois finalisé, serait un excellent moyen pour parer aux critiques inévitables » (p. 235-236). Rappelons que l’OCDE est une organisation internationale qui participe directement à l’amplification des politiques néolibérales surtout en leur donnant une caution pseudo-scientifique |13|. Chercher à rompre la stigmatisation ne veut pas dire encenser des institutions hostiles à l’abandon des réformes structurelles néolibérales.
11 février. La première réunion de l’Eurogroupe avec le gouvernement grec.
Le témoignage de Varoufakis sur la composition et le fonctionnement de l’Eurogroupe est tout à fait utile et c’est une des raisons de prendre la peine de lire son livre.
« L’Eurogroupe est une drôle de créature. Les traités européens ne lui confèrent aucun statut légal, mais c’est le corps constitué qui prend les décisions les plus importantes pour l’Europe. La majorité des Européens, y compris les politiques, ne savent pas exactement ce que c’est, ni comment il fonctionne, mais je vais vous expliquer. Les participants s’installent autour d’une grande table rectangulaire, et les ministres des Finances de chaque pays se répartissent des deux côtés ». Il ajoute, et c’est essentiel : « le vrai pouvoir est aux deux bouts de la table. D’un côté, à ma gauche, était assis Jeroen Dijsselbloem. A sa droite, il avait Thomas Wieser, président du Groupe de travail et détenteur du vrai pouvoir à cette extrémité-là ; à sa gauche, se trouvaient les représentants du FMI, Christine Lagarde et Poul Thomsen. A l’autre extrémité de la table, était assis Valdis Dombrovskis, commissaire chargé de l’euro et du dialogue social, dont le vrai job était de superviser (au nom de Wolfgang Schäuble) Pierre Moscovici, assis à gauche de cet économiste letton. A la droite de Dombrovskis, Benoît Cœuré, puis Mario Draghi, qui représentaient la BCE. Du même côté que Draghi, mais sur la longueur et en angle droit par rapport à lui était assis Wolfgang Schäuble. Leur proximité créait des étincelles, mais jamais de lumière » (p. 237).
En quelque sorte, l’Eurogroupe est l’institutionnalisation de la Troïka car il réunit la BCE, le FMI, les ministres des Finances de la zone euro et les représentants de la Commission européenne.
« Les réunions de l’Eurogroupe suivent un rituel qui montre à quel point la troïka et ses usages ont fait main basse sur la gouvernance de l’Europe continentale » (p. 237).
« Chaque fois qu’un thème est abordé – par exemple, le budget français, ou le développement des banques chypriotes –, Dijsselbloem l’annonce tout haut, puis invite chaque représentant des institutions à s’exprimer sur le sujet : Moscovici pour la Commission européenne, Christine Lagarde pour le FMI (ou Poul Thomsen si elle est absente), enfin, Mario Draghi pour la BCE (Benoît Cœuré intervenant les jours, rares, où Draghi n’est pas là). Une fois que chacun des représentants non élus a donné le la en livrant sa déclaration et en énonçant les termes de la discussion, les ministres élus peuvent s’exprimer. A chaque réunion à laquelle j’ai assisté ou presque, les ministres n’ont eu droit à aucun temps réservé pour présenter un exposé substantiel sur le sujet débattu » (p. 237-238).
Selon Varoufakis : « l’Eurogroupe n’est là que pour permettre aux ministres de valider et légitimer les décisions prises en amont par les trois institutions » (p. 238).
Varoufakis précise qu’il était accompagné de Dragasakis et de Chouliarakis, le Président du Conseil des économistes (que Dragasakis avait placé dans l’équipe de Varoufakis).
« Notre gouvernement est ici pour mériter une monnaie très précieuse sans dilapider un bien capital important puisque nous devons mériter votre confiance sans perdre celle de notre peuple » (p. 238) (je souligne).
Il explique ensuite qu’il est très important pour le gouvernement grec de prendre de nouvelles mesures pour corriger les précédentes, injustes, et répondre à la crise humanitaire (réembaucher du personnel qui a été licencié, augmenter les retraites de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, rétablir le salaire minimum dans le secteur privé).
« Les membres de l’Eurogroupe pouvaient compter sur moi, dis-je, pour qu’aucune de ces micro-mesures n’ait d’impact budgétaire » (p. 239).
« [J]’ai mentionné notre lien avec l’OCDE et proposé de travailler étroitement avec le FMI et la BCE dans leurs domaines d’expertise » (p. 239).
Il explique que sur les privatisations, le gouvernement ne sera pas dogmatique. Certaines privatisations pourront avoir lieu.
Il exprime la volonté de créer une banque publique de développement et d’y ajouter une autre banque publique à créer en collaboration avec la BCE afin de prendre en charge les prêts non performants des banques privées.
Il prononce une phrase terrible dans la continuité de ce qu’il avait annoncé au parlement : « notre gouvernement (…) s’était engagé à respecter le programme de ses prédécesseurs » (p. 239)
Ensuite, il aborde la question de la dette : « La troïka exigeait que l’État grec en faillite verse presque 5 milliards d’euros au FMI avant juillet 2015, puis 6,7 milliards à sa propre banque centrale en juillet et août 2015. Je proposais que l’on commence par une mesure raisonnable : que la BCE verse à la Grèce les 1,9 milliards qu’elle lui devait pour les bénéfices de nos obligations SMP [c’est-à-dire les titres que la BCE avait achetés aux banques privées entre 2010 et 2012. Note d’Éric Toussaint]. Cet argent appartenait à la Grèce. Si les créanciers voulaient que nous les remboursions, nous y donner accès était le minimum. Proposer moins était nous inciter au défaut de paiement. »
Varoufakis ajoute, dans une note de bas de page, ce que nous avons expliqué dans la partie consacrée à son exposé au Parlement grec deux jours plus tôt, à savoir qu’il savait quand il a dit cela que « la Troïka avait décidé de garder cet argent ». Il le savait depuis la veille des élections grâce au document de Thomas Wieser, vice-président de l’Eurogroupe, qui leur était parvenu (chapitre 8, page 513, note 7). De mon côté, j’ai également relaté cela au début de la partie 5.
Bien sûr, Varoufakis avait raison de demander que cette somme de près de 2 milliards € soit versée au gouvernement grec.
Il conclut en précisant que le gouvernement grec souhaite « de vraies négociations, menées de bonne foi, pour créer un nouveau contrat, fondé sur un objectif d’excédent primaire réaliste, et des politiques structurelles efficaces et socialement équitables – y compris les nombreux éléments du programme précédent que nous acceptons. Nous avons besoin de garanties sur ce point précis » (p. 240).
Puis il ajoute : « Une telle ouverture ne saurait être interprétée comme l’acceptation de la logique de l’agenda précédent, que les Grecs ont rejeté » (p. 240). Cette précision est totalement en contradiction avec une autre partie de son discours que nous avons citée lorsqu’il déclare : « notre gouvernement (…) s’était engagé à respecter le programme de ses prédécesseurs ».
Dans la discussion qui a suivi, Schäuble a tout de suite déclaré : « Des élections ne sauraient changer une politique économique » (p. 241). Il a été appuyé par les interventions des ministres des Finances des républiques baltes, de Slovénie, de Slovaquie, de Finlande, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Autriche, de l’Irlande…
Varoufakis dit avoir, dans sa réponse, déclaré : « si vous êtes d’accord avec Wolfgang, je vous invite à le dire explicitement en proposant que l’on suspende les élections dans les pays comme la Grèce jusqu’à ce que le plan prévu pour ce pays soit mené à bien » (p. 242).
Jeroen Dijsselbloem et Thomas Wieser (vice-président de l’Eurogroupe) refusent alors que les trois documents préparés par Varoufakis pour l’Eurogroupe soient distribués.
On en vient au projet de communiqué qui devait être publié à l’issue de la rencontre. Varoufakis raconte : « J’ai jeté un œil sur le texte et j’ai tout de suite vu qu’il était inacceptable : il engageait explicitement la Grèce à appliquer jusqu’au bout le second plan de renflouement en appliquant l’intégralité du MoU « avec une flexibilité maximum au sein du plan pour s’accorder aux priorités des nouvelles autorités grecques » » (p. 243).
Varoufakis demande que le mot « amendé » soit ajouté après le mot « plan ». Schäuble refuse cet amendement en disant que, si l’on amende le mémorandum, il faudra repasser par un vote du parlement allemand, ce qui n’est pas concevable.
Varoufakis refuse. En conséquence, on menace la Grèce : s’il n’y a pas d’accord sur un communiqué, la BCE coupera totalement les liquidités aux banques grecques à l’issue du second mémorandum, c’est-à-dire le 28 février. Varoufakis refuse cet ultimatum. Dijsselbloem lui propose de renoncer à proposer le mot « amendé » et de le remplacer par « ajusté ». Varoufakis accepte à condition que le texte mentionne qu’en Grèce, il y a une crise humanitaire. Dijsselbloem refuse. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, met la pression sur Varoufakis.
Varoufakis consulte alors par téléphone Tsipras et Pappas qui eux aussi étaient à Bruxelles, installés dans un hôtel dans l’attente de la réunion de leur premier sommet européen qui allait commencer le lendemain. La conversation dure une heure. Varoufakis raconte : « J’ai dû changer trois ou quatre fois d’avis, oscillant entre « Allez vous faire foutre ! » et « On accepte ce putain de communiqué et on se battra le jour où il faudra définir précisément ce “plan ajusté”. » Pendant ce temps-là, Dragasakis me faisait signe de conseiller à Alexis de céder » (p. 247).
Finalement, Tsipras dit à Varoufakis de refuser le texte, ce qui met fin à cette réunion de l’Eurogroupe. Varoufakis résume ce premier round de l’Eurogroupe : « Les ministres des Finances de dix-neuf pays européens, les dirigeants de la BCE, du FMI et de la Commission européenne, sans compter les conseillers, les interprètes et le personnel d’appoint venaient de perdre dix heures à faire chanter un ministre. Quel gâchis ».
Il se rend dans le bureau de la délégation et appelle Tsipras pour un rapide bilan.
« – Réjouis-toi ! s’exclama-t-il. Les gens font la fête dans les rues, ils sont avec nous. C’est génial !
problème) ; 2. Le mémorandum est prolongé jusqu’au 30 juin (cela arrange Varoufakis).
« J’ai dit à Jeroen (Dijsselbloem) que je lui concédais ces deux points, sans conséquences de mon point de vue, à condition qu’il m’accorde une chose : une certaine marge d’action » (p. 274). Il poursuit : « j’exigeais que le MoU, en tout cas les 30% des articles que je jugeais inacceptables, soient remplacés par une liste de réformes émanant de nous, tandis que l’excédent primaire visé serait réduit de 4,5 % à 1,5 % du revenu national » (p. 274).
Varoufakis ajoute « Stupeur : Jeroen acceptait. » Or, et c’est l’abc d’une négociation, si dès le départ votre ennemi accepte vos conditions, c’est que vous avez mal engagé celles-ci.
Dijsselbloem acceptait également que ce soit la Grèce qui remette une liste de propositions de réformes que les institutions de la Troïka auraient le loisir d’approuver ou de rejeter.
Varoufakis écrit : « Si cette introduction passait la barre pour figurer dans le communiqué final, ce serait une victoire pour les pays les plus faibles de la zone euro. Pour la première fois, un pays Une secrétaire m’a montré un tweet sur son compte, avec la photo d’un rassemblement et le message suivant : « Dans toutes les villes de Grèce et d’Europe les gens se battent avec nous. Notre force, c’est eux. » C’était vrai, je l’ai découvert le lendemain : des milliers de gens étaient réunis place Syntagma pendant que j’étais enfermé avec l’Eurogroupe, dansant et brandissant des banderoles proclamant « en faillite mais libres » ou « fin à l’austérité ». Au même moment, c’était encore plus émouvant, des milliers de manifestants allemands emmenés par le mouvement Blockupy encerclaient le bâtiment de la BCE à Francfort en signe de solidarité » (p. 249).
Cela montre parfaitement quel potentiel de mobilisation il y aurait eu si, dans les jours qui ont suivi, Tsipras et Varoufakis avaient maintenu une ligne de refus des ultimatums, s’ils avaient mis en pratique la suspension de paiement, l’audit, la décote unilatérale des titres détenus par la BCE, s’ils avaient mis en place un système de paiements parallèles, s’ils avaient exercé leur droit de vote dans les banques grecques et s’ils avaient décrété un contrôle des mouvements de capitaux.
Mais revenons au récit de Varoufakis. Il explique qu’après être passé par le bureau de la délégation grecque et avoir pris connaissance avec bonheur des mobilisations, il a donné comme il se doit une conférence de presse. Selon sa narration, il a déclaré ce qui suit à propos de la réunion de l’Eurogroupe : « L’accueil a été très chaleureux et ce fut l’occasion parfaite pour présenter nos analyses, nos points de vue et nos propositions, à la fois sur le fond et par rapport à la feuille de route. Sachant que nous nous reverrons lundi, nous poursuivrons normalement et tout naturellement avec cette deuxième réunion » (p. 250).
« Plusieurs amis et critiques m’ont reproché d’avoir déçu la population. Combien de fois m’a-t-on demandé : Pourquoi ne pas avoir révélé ce qui s’était passé ? Pourquoi ne pas avoir parlé de leur chantage et de leur mépris de la démocratie ? Voilà ce que je réponds : parce que ce n’était pas encore le moment » (p. 250).
En fait à partir de ce moment-là, et à part lors d’un évènement intervenu cinq jours plus tard le 16 février, Varoufakis entre dans une logique infernale : ce ne sera jamais le bon moment pour dire la vérité sur ce qui se passe au niveau de la négociation. À partir du 20 février jusqu’à la capitulation finale de juillet 2015, Varoufakis adoptera une attitude conforme à la politique de la diplomatie secrète.
Alors que tant de micros et de caméras se tournaient vers lui quand il était ministre, il n’a jamais utilisé, à part le 16 février, la possibilité qui lui était offerte d’informer l’opinion publique sur ce qui se passait réellement dans la négociation. Il en a été de même pour Alexis Tsipras sauf pour un temps très court à la fin du mois de juin 2015 quand il s’est agi d’appeler au référendum du 5 juillet.
12 février. Une concession, vraiment ?
Varoufakis explique que ce refus de signer a convaincu les dirigeants européens de faire une concession. Dijsselbloem, apparemment sous l’injonction d’Angela Merkel, prend contact avec Tsipras en proposant d’annoncer que le gouvernement grec et l’Eurogroupe allaient discuter des paramètres techniques pour avancer dans l’exécution du plan en cours en tenant compte des objectifs du nouveau gouvernement. On peut se demander si Varoufakis a raison d’affirmer qu’il s’agissait d’une concession. Rien n’est moins sûr. Les dirigeants européens, en parlant d’exécution du plan, maintenaient leur point de vue. En même temps, ils voulaient donner l’impression qu’ils étaient ouverts à la négociation tout en démontrant que le gouvernement grec était incapable de se comporter de manière responsable et constructive.
Par ailleurs, Varoufakis explique qu’à partir de ce moment-là s’est établi un contact direct entre Merkel et Tsipras, ce qui allait par la suite avoir des effets négatifs.
Angela Merkel et Alexis Tsipras
Il ajoute que Tsipras a commencé à s’éloigner de lui qui était le seul ministre à être convaincu qu’il fallait être prêt à prendre des mesures unilatérales comme la décote des titres détenus par la BCE ou la suspension de paiement. En écrivant cela il omet le fait que Lafazanis, qui était un de six principaux ministres, était également favorable à des actions unilatérales, à commencer par la suspension de paiement. Sans parler des quatre vice-ministres membres de la Plateforme de gauche (Nadia Valavani, Dimitris Stratoulis, Costas Isychos, Nikos Chountis) et de la présidente du parlement grec, Zoé Konstantopoulou. En fait, Varoufakis révèle ainsi qu’il n’a jamais imaginé sérieusement faire un front avec d’autres membres du gouvernement et du parlement afin de mettre en pratique une orientation à la hauteur des attaques de la Troïka. Varoufakis, en expliquant aux lecteurs qu’il était seul, cherche de manière en partie inconsciente des circonstances atténuantes pour son attitude timorée.
13-14-15 février à Bruxelles
Varoufakis est resté à Bruxelles après la réunion du 11 jusqu’à la réunion suivante de l’Eurogroupe, convoquée pour le 16 février. Selon Varoufakis : « La chancelière allemande voulait que notre équipe technique rencontre celle de la troïka pour commencer à discuter des propositions et des priorités de notre gouvernement » (p. 255). Varoufakis rassemble une équipe composée de Chouliarakis, de quatre conseillers de Dragasakis, d’Elena Panaritis et de Glenn Kim, qui sont chargés de travailler avec l’équipe de la Troïka à une tentative de rapprochement (pour en savoir plus sur ces conseillers de Varoufakis, voir la partie 4). Dans les coulisses, selon Varoufakis, il y avait aussi un envoyé de la Banque Lazard et James Galbraith. En plus, Varoufakis recevait des conseils à distance de la part de Jeffrey Sachs et de William Buiter (économiste en chef de la banque nord-américaine Citigroup).
En marge des réunions officielles de travail qui se sont déroulées ces jours-là à Bruxelles, Varoufakis a adopté une position sur les contrôles de capitaux : il s’y est opposé. Il ne faut pas s’étonner que ses conseillers de la banque Lazard et de Citigroup, tout comme ceux étant passés comme Panaritis et Sachs par la Banque mondiale, étaient totalement contre tout contrôle de capitaux. Galbraith l’était aussi.
C’était une grave erreur, c’est le moins qu’on puisse dire. Il aurait fallu imposer un contrôle afin d’éviter la fuite des capitaux. Évidemment, il ne fallait pas empêcher des envois modestes de fonds à l’étranger. Il fallait un contrôle sélectif sur les gros flux financiers. C’était tout à fait faisable.
Le 14 février, Tsipras remet à Varoufakis un projet de communiqué que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker lui a fait parvenir. Ce projet était d’un tout autre ton que celui que Dijsselbloem et Schäuble avaient voulu imposer le 11 février, mais ce n’était qu’un leurre. Dès le lendemain, Varoufakis a dû déchanter. Alors que l’après-midi du 15 avait bien commencé par une rencontre avec Moscovici, qui lui soumettait le texte de Juncker que Varoufakis était prêt à signer, un peu plus tard, Dijsselbloem lui a communiqué un autre texte. Varoufakis raconte : « J’ai lu. C’était pire que la version qu’on avait refusée à la première réunion. Le texte engageait le gouvernement grec à « appliquer le plan en cours », ne nous autorisant à poursuivre notre mandat que dans le cadre « de la flexibilité existante comprise dans le plan en cours ». Toutes les concessions proposées par Juncker la veille et par Pierre quelques instants plus tôt avaient été expurgées. Même l’expression « plan ajusté » avait disparu. Sa version signifiait le retour du plan tel quel, en force, sans le moindre adjectif pour l’atténuer » (p. 265).
16 février à Bruxelles, deuxième échec de l’Eurogroupe
Le 16 février, la deuxième réunion de l’Eurogroupe se termine rapidement sur un échec puisque le texte soumis à la Grèce est pire que celui qu’elle avait refusé quelques jours plus tôt.
Lors de la conférence de presse qui a suivi, c’est quasiment la seule fois où Varoufakis explique publiquement qu’il y a un désaccord. Il résume ce qu’il a déclaré à la presse : « J’ai le plaisir de vous annoncer que les négociations se sont déroulées dans un esprit collégial, révélateur d’une vraie communauté de vue […] pour établir un terrain d’entente et arriver à un accord viable entre la Grèce, l’Europe officielle et le FMI. Je ne doute pas qu’elles se poursuivront demain et après-demain jusqu’à ce que nous obtenions cet accord. Si c’est le cas, pourquoi ne nous sommes-nous pas entendus sur un communiqué, une formule qui débloquerait les délibérations ?
La vraie raison c’est qu’il existe un profond malentendu sur notre mission : faut-il appliquer un plan que nous avons été élus pour remettre en cause ? Ou faut-il s’asseoir dans un esprit d’ouverture pour repenser ce plan qui, nous l’estimons et la majorité des personnes douées de discernement l’estiment également, a échoué à stabiliser la Grèce, a produit une tragédie humaine et a rendu la Grèce d’autant plus difficile à réformer ? » (p. 266-267).
Varoufakis explique à la presse ce qui s’est passé entre le 11 et le 16 février et il ajoute pour les lecteurs que pour la deuxième fois en cinq jours, le gouvernement grec avait dit non à la Troïka.
Ce deuxième refus a donné lieu à des manifestation de soutien au gouvernement en Grèce et la cote de popularité du gouvernement a atteint 75 %.
Mais Varoufakis et Tsipras n’ont jamais adressé un appel au soutien des populations d’Europe et d’ailleurs. Cela a joué un rôle non négligeable dans la difficulté de développer un puissant mouvement de solidarité internationale avec le peuple grec. Bien sûr, il aurait aussi fallu utiliser à fond les possibilités de communication données par les réseaux sociaux, ce qui n’a pas été fait par le gouvernement grec et par le noyau dirigeant autour de Tsipras. Le fait de fonctionner dans le cadre de la diplomatie secrète a également encouragé les dirigeants européens à maintenir les pires pratiques de chantage sans courir le risque que celles-ci soient dénoncées.
17-18-19 février à Athènes, le tournant vers l’accord du 20 février et le prolongement du mémorandum
Varoufakis explique que lors de la première réunion de ce qu’il appelle le « cabinet de guerre », après l’échec du 16 février, Tsipras, Pappas et Dimitris Tzanakopoulos, chef de cabinet de Tsipras, étaient favorables à rompre les négociations. Varoufakis précise que Tzanakopoulos lui a hurlé : « Si tu veux signer le MoU (le mémorandum – Note de l’auteur), ça sera sans moi, je te le garantis ! » Concernant Tsipras, il écrit : « il lui arrivait de perdre son sang-froid et de menacer de planter les négociations » (p. 269). Spyros Sagias (secrétaire de cabinet) et Varoufakis étaient partisans de poursuivre les négociations.
Varoufakis finit par convaincre le reste du cabinet de guerre qu’il faut obtenir une prolongation du mémorandum. « Mon point de vue, partagé par Sagias et Dragasakis, était le suivant : demander un prolongement faisait partie de notre mandat à partir du moment où on ne s’engageait pas à appliquer le plan tel quel » (p. 271).
J’argumenterai dans l’article suivant pourquoi il aurait mieux valu refuser une prolongation du deuxième mémorandum.
Varoufakis, de son côté, voulait un prolongement du mémorandum alors qu’il était bien conscient que Berlin posait quatre exigences : poursuivre les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité (cela voulait dire très clairement poursuivre les attaques contre les salaires, la sécurité sociale et aller plus loin dans les privatisations), maintenir le FMI dans un futur accord (ce qui impliquait de prolonger le deuxième mémorandum en cours par un troisième mémorandum même si Varoufakis ne le reconnaît pas |14|), définir ce qu’est la soutenabilité de la dette et surtout : « Reconnaître les obligations financières de la Grèce vis-à-vis de tous ses créanciers » (p. 271).
Ce dernier point a provoqué de fortes réactions dans le cabinet. Dimitris Tzanakopoulos, chef de cabinet, y était opposé : « – Pourquoi faudrait-il reconnaître notre dette vis-à-vis de tous les créanciers ? »
Varoufakis explique qu’il a répliqué : « nous pourrions « reconnaître » notre dette en insistant pour qu’elle soit immédiatement restructurée et – j’ai martelé ce point – pour que nos créanciers récupèrent leur argent |15|. L’aile de Syriza qui exigeait des décotes immédiates et unilatérales parce que la dette était illégale en soi serait scandalisée, mais l’option a fini par être avalisée par le cabinet de guerre. Il était prévu que j’écrive à l’Eurogroupe pour soumettre une demande officielle de prolongement » (p. 271-272).
Cette décision allait très clairement à l’encontre du programme de Syriza et du gouvernement.
Par ailleurs, Varoufakis explique que « le scénario le plus probable » poursuivi par les dirigeants européens était le suivant : « la prolongation était un leurre, en retardant la solution ; ils attendaient que notre popularité s’essouffle, ainsi que nos réserves de liquidité, jusqu’à la date d’expiration, en juin, où notre gouvernement serait à bout de forces et capitulerait » (p. 272).
Varoufakis affirme que, face à ce scénario il a obtenu l’accord du cabinet de guerre pour « demander cette prolongation tout en signalant trois choses à la Troïka : à toute tentative d’épuisement via un resserrement de liquidités nous répondrons par un refus d’honorer les remboursements dus au FMI ; à toute velléité de nous renfermer dans la camisole d’un plan bancal ou de nous refuser une restructuration nous répondrons par l’arrêt des négociations ; à toute menace de fermeture des banques et de contrôles des capitaux nous répondrons par la décote unilatérale des obligations SMP, suivie par la mise en place du système de paiement parallèle et la modification des règles de la Banque centrale de Grèce pour restaurer la souveraineté du Parlement sur ladite banque. »
Le problème c’est que, jamais au grand jamais, cette menace n’a été communiquée à la Troïka. Elle n’a jamais non plus été rendue publique. Varoufakis le reconnaît. Quant à sa mise en pratique, comme on le verra par la suite, Tsipras et la majorité du cabinet s’y sont clairement opposés et Varoufakis a accepté cela jusqu’à la capitulation finale de juillet 2015.
Par ailleurs, à ce stade, nous ne disposons que du témoignage de Varoufakis. Aura-t-on un jour un témoignage confirmant son affirmation ? Il est tout à fait improbable que Tsipras confirme la version de Varoufakis car ce serait l’aveu de sa propre culpabilité.
Tout s’est passé en comité très restreint et le reste du gouvernement n’a jamais été informé, ni la direction de Syriza. La population grecque a été totalement maintenue à l’écart.
La menace dont parle Varoufakis n’a de toute façon jamais été communiquée à la Troïka.
Varoufakis écrit : « Le pire serait de demander une prolongation, de l’obtenir et de ne pas signaler notre détermination à passer à l’acte si les créanciers s’éloignaient de l’esprit de l’accord intermédiaire. Si nous commettions l’erreur, ils nous traîneraient dans la boue pendant toute la prolongation, jusqu’à ce qu’on soit exsangues et qu’ils puissent nous achever » (p. 272). Or, c’est exactement ce qui s’est passé. Varoufakis, avec l’accord du noyau autour de Tsipras, a demandé la prolongation du mémorandum sans signaler une quelconque détermination à passer à l’action et les créanciers ont traîné dans la boue le gouvernement puis l’ont amené à capituler officiellement.
Varoufakis a envoyé le 18 février à l’Eurogroupe une lettre dont il cite des passages terribles :
« Les autorités grecques reconnaissent les obligations financières vis-à-vis de tous les créanciers ». Elles comptent « coopérer avec leurs partenaires afin de contourner les obstacles techniques dans le cadre de l’accord de prêt dont nous reconnaissons la contrainte. » |16| Varoufakis ajoute qu’il ne pouvait « pas aller plus loin pour satisfaire Berlin » (p. 273). C’est le moins qu’on puisse dire.
20 février à Bruxelles : en route vers la capitulation
Varoufakis se rend à Bruxelles et, juste avant le début de l’Eurogroupe, Dijsselbloem lui annonce deux mauvaises nouvelles, qui n’en sont pas aux yeux de Varoufakis : 1. Le solde de 11 milliards € du Fonds de recapitalisation des banques (FHSF) sur lequel le gouvernement Tsipras comptait pour réaliser une partie de ses promesses électorales part vers le Luxembourg au lieu d’être mis à disposition de la Grèce (Varoufakis considère que ce n’est pas un
prisonnier d’un plan de renflouement serait autorisé à remplacer le MoU de la Troïka par son propre agenda de réformes » (p. 275). C’est du délire total. Voir dans l’encadré ci-dessous des extraits de l’accord signé par Varoufakis avec l’Eurogroupe le 20 février à Bruxelles.
| L’Accord signé par Varoufakis lors de la réunion de l’Eurogroupe le 20 février |17| (Extraits)« Les autorités grecques présenteront une première liste de mesures de réforme, sur la base de l’accord actuel, au plus tard le lundi 23 février. Les institutions (il s’agit de la BCE, du FMI et de la Commission européenne, note d’Éric Toussaint) fourniront un premier avis visant à déterminer si cette liste est suffisamment complète pour être considérée comme un point de départ valable en vue d’une conclusion réussie de l’évaluation. Cette liste sera encore précisée puis soumise à l’approbation des institutions d’ici la fin avril. Seule l’approbation, par chacune des institutions, de la conclusion de l’évaluation de l’accord prolongé, permettra tout déblocage de la tranche restant due de l’actuel programme du FESF [Fonds européen de stabilité financière] et le transfert des bénéfices de 2014 dégagés dans le cadre du SMP [Programme pour les marchés de titres]. Les deux sont à nouveau soumis à l’approbation de l’Eurogroupe. » (…) « Les autorités grecques réitèrent leur engagement sans équivoque à honorer, pleinement et à temps, leurs obligations financières auprès de tous leurs créanciers. Les autorités grecques se sont également engagées à assurer les excédents budgétaires primaires requis ou les produits de financement nécessaires pour garantir la viabilité de la dette, conformément à la déclaration de l’Eurogroupe de novembre 2012. » (…) « À la lumière de ces engagements, nous nous félicitons que, dans un certain nombre de domaines, les priorités politiques de la Grèce puissent contribuer à un renforcement et une meilleure mise en œuvre de l’accord actuel. Les autorités grecques s’engagent à s’abstenir de tout démantèlement des mesures et de changements unilatéraux des politiques et réformes structurelles qui auraient un impact négatif sur les objectifs budgétaires, la reprise économique ou la stabilité financière, tels qu’évalués par les institutions. » |
Selon Varoufakis, euphorique, il y avait quand même un hic : « Le communiqué avait un inconvénient : aucun assouplissement du resserrement des liquidités n’était prévu » (p. 275). Bref, l’asphyxie de la Grèce commencée officiellement le 4 février continuerait.
La corde qui étranglait la Grèce allait fonctionner comme un nœud coulant : tandis que celle-ci devait rembourser 7 milliards de dettes avant le 30 juin 2015, les créanciers ne feraient aucun versement d’argent frais et pire, la BCE continuerait de limiter l’accès des banques grecques aux liquidités d’urgence. Cela diminuerait leur capacité à acheter des titres émis par le trésor grec pour se financer et cela renforcerait l’asphyxie du gouvernement.
Varoufakis explique qu’au cours de l’Eurogroupe, il a reçu un SMS d’Emmanuel Macron lui demandant des nouvelles et qu’il lui a répondu : « On a eu un bon résultat. Maintenant il faut remonter les manches. Merci pour votre aide. ». Varoufakis ajoute : « Il a réagi en camarade : « Continuons à nous battre » » (p. 278).
Ensuite, Varoufakis donne une conférence de presse : « J’ai remercié Jeroen d’avoir gardé le cap et j’ai ajouté que ce serait l’occasion de s’y mettre. Pendant le week-end, mon équipe et moi allions établir la liste des réformes à soumettre dans les trois jours suivants.
– Il va falloir travailler d’arrache-pied, mais ce sera avec plaisir puisque nous partons d’une relation entre égaux. » |18| (p. 279)
En réalité, l’accord du 20 février est égal à l’acte d’un vassal qui se soumet au suzerain tout en proclamant qu’il est l’égal du suzerain. Rappelons les paroles tenues par Varoufakis dix jours plus tôt au parlement grec : « Si vous n’envisagez pas de pouvoir quitter la table des négociations, il vaut mieux ne pas vous y asseoir. Si vous ne supportez pas l’idée d’arriver à une impasse, autant vous en tenir au rôle du suppliant qui implore le despote de lui accorder quelques privilèges, mais finit par accepter tout ce que le despote lui donne » (p. 233).
Varoufakis rend compte des réactions contradictoires : Jeffrey Sachs le félicite tandis qu’il est durement critiqué par Manólis Glézos, flambeau de la Résistance et député Syriza au Parlement européen depuis février 2015, et le célèbre compositeur Míkis Theodorákis, deux héros de son enfance pour reprendre ses termes (p. 282). Dans un communiqué public, Manólis Glézos s’est excusé auprès du peuple grec d’avoir appelé à voter Syriza en janvier 2015.
Varoufakis explique qu’à partir du 21 février, il s’attelle à rédiger les propositions de réformes à « intégrer au MoU » et à soumettre à l’Eurogroupe le 23 février. Varoufakis n’hésite donc pas à dire aujourd’hui qu’il s’agissait d’essayer d’amender le mémorandum en cours, alors qu’à l’époque, Tsipras et lui disaient à la population qu’il s’agissait d’un nouvel accord et que la Grèce s’était libérée de la prison du mémorandum et de la Troïka, rebaptisée « les institutions ».
Varoufakis écrit que le lundi 23 février au soir, « le texte serait envoyé à Christine Lagarde, Mario Draghi et Pierre Moscovici qui auraient la matinée du lendemain pour l’examiner avant la téléconférence de l’Eurogroupe du mardi après-midi. Ils seraient trois à évaluer les mesures avant de donner leur feu vert ou leur veto, sans que les ministres aient leur mot à dire » (p. 283). Comment dès lors peut-on affirmer, comme Varoufakis l’a fait en public à l’époque, que la Troïka n’existait plus et que la Grèce avait retrouvé la liberté ? Il reconnaît lui-même qu’il a accepté de soumettre à Lagarde (FMI), Draghi (BCE) et Moscovici (Commission européenne) les propositions que le gouvernement grec comptait envoyer ensuite officiellement à l’Eurogroupe.
Conclusion
En signant le 20 février 2015 un accord avec l’Eurogroupe selon lequel « Les autorités grecques réitèrent leur engagement sans équivoque à honorer, pleinement et à temps, leurs obligations financières auprès de tous leurs créanciers » et « s’engagent à s’abstenir de tout démantèlement des mesures et de changements unilatéraux des politiques et réformes structurelles », Varoufakis et Tsipras rompaient avec l’engagement de mettre fin au mémorandum et de le remplacer par un plan de reconstruction. Ils renonçaient à mettre en cause la légitimité de la dette et à en suspendre le paiement. Ils soumettaient à nouveau la Grèce au bon vouloir de la Troïka. Il était certain que celle-ci n’allait pas avaliser un programme de mesures permettant au gouvernement de concrétiser ses promesses. L’accord du 20 février est le premier document officiel par lequel Varoufakis et Tsipras abandonnent les propositions principales du programme pour lequel le Syriza avait été porté au gouvernement.
Comme l’écrivait Stathis Kouvelakis dans une interview à Alexis Cukier réalisée en 2015 « Les choses sont assez simples en réalité : les institutions européennes cherchent à construire une cage de fer dans laquelle on veut à tout prix enfermer le nouveau gouvernement pour l’empêcher de réaliser son programme. Il s’agit de montrer qu’une politique de sortie de l’austérité et du néolibéralisme est impossible dans le cadre actuel, et que, quels que soient les mandats confiés par les populations au gouvernement, quels que soient les résultats des élections, c’est toujours les mêmes politiques qui s’appliqueront. Leur premier objectif est clairement d’humilier Syriza et de mettre à genoux le nouveau gouvernement grec. Il s’agit également d’un avertissement adressé à Podemos et à toute autre force qui, en Europe, serait susceptible d’arriver au pouvoir et de remettre en cause les politiques d’austérité et le mécanisme de l’endettement. » |19|
De son côté le CADTM Europe avait publié le 31 décembre 2014 un communiqué qui sonne comme un avertissement : « Les puissants d’Europe et du monde entier n’ont même pas attendu la dissolution du Parlement grec et l’ouverture de la campagne électorale pour lancer leur nouvelle offensive de mensonges et de chantages qui visent à terroriser les citoyens grecs afin qu’ils ne votent pas aux prochaines élections du 25 janvier 2015 en faveur de SYRIZA, la Coalition de la Gauche Radicale grecque. En effet, secondés par les grands médias européens, « ceux d’en haut » du nom de Juncker, Merkel, Hollande, Renzi ou Moscovici commencent leur énième intervention brutale dans les affaires intérieures de cette Grèce, qu’ils ont d’ailleurs transformée en un amas de ruines sociales depuis qu’ils lui ont imposé leurs politiques d’austérité inhumaines et barbares.
Le CADTM n’a pas le moindre doute sur les intentions véritables de ceux qui ont fait de la Grèce le laboratoire européen de leurs politiques néolibérales les plus extrêmes et des Grecs des véritables cobayes de leur thérapie économique, sociale et politique de choc. On doit s’attendre à une escalade de leur offensive car ils ne peuvent pas se permettre que SYRIZA réussisse et fasse des émules en Europe ! Ils vont utiliser tous les moyens dont ils disposent car ils sont bien conscients que ce qui est en jeu aux prochaines élections grecques est le succès ou l’échec de la guerre sociale qu’ils mènent contre l’écrasante majorité des populations de toute l’Europe ! C’est d’ailleurs parce que l’enjeu est si important qu’on doit s’attendre à ce que « ceux d’en haut » d’Europe et de Grèce ne respectent pas le verdict des urnes, qui devrait couronner, pour la première fois de l’histoire, la victoire de la gauche grecque. Sans aucun doute, ils vont par la suite essayer d’asphyxier le gouvernement de gauche sorti des urnes, parce que son éventuel succès serait sûrement interprété comme un formidable encouragement à la résistance par les travailleurs et les peuples d’Europe. »
Nous verrons dans la prochaine partie que Varoufakis avec l’accord de Tsipras signera quelques jours après le 20 février 2015 un document rédigé par la Troïka reconnaissant de fait la primauté du mémorandum en cours par rapport aux mesures proposées par le gouvernement grec.
Notes
|1| Les trois premiers paragraphe de cette partie sont tirés de l’introduction de l’article précédent
|2| Ministre fédéral des Finances du 28 octobre 2009 au 24 octobre 2017. Depuis cette date, il préside le Bundestag.
|3| Y. Varoufakis, Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Les Liens Qui Libèrent, Paris, 2017, chapitre 7, p. 217
|4| Y. Varoufakis, op.cit., chapitre 7, p. 218
|5| Y. Varoufakis, op.cit., chapitre 7, p. 218
|6| D’ailleurs, on éprouve vraiment des difficultés à croire que Varoufakis, Tsakalotos et le cercle dirigeant autour de Tsipras aient vraiment pu penser que cette proposition pourrait convaincre les dirigeants européens.
|7| Les pays qui font partie de la zone euro ne peuvent pas dévaluer leur monnaie puisqu’ils ont adopté l’euro. Des pays comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne sont donc coincés par leur appartenance à la zone euro. Les autorités européennes et leur gouvernement national appliquent dès lors ce qu’on appelle la dévaluation interne : ils imposent une diminution des salaires au grand profit des dirigeants des grandes entreprises privées. La dévaluation interne est donc synonyme de réduction des salaires. Elle est utilisée pour augmenter la compétitivité mais on constate qu’elle est très peu efficace pour retrouver de la croissance économique car les politiques d’austérité et de répression salariale sont appliquées dans tous les pays. Par contre, du point de vue des patrons, la crise de la zone euro qui a pris un caractère très aigu à partir de 2010-2011 constitue une aubaine : le salaire minimum légal a été réduit fortement en Grèce, en Irlande et dans d’autres pays.
|8| Varoufakis ajoute : « A l’heure où j’écris, Michael Christoforakos coule des jours tranquilles en Allemagne, Stournaras est toujours gouverneur de la Banque centrale de Grèce, le scandale Siemens n’a pas conduit le moindre homme politique devant la justice » (ibid., p. 223). Il faut savoir que Stournaras avait proposé en 2012 au parlement grec une résolution extrajudiciaire signée avec Siemens qui mettait fin à toute poursuite. J’ajoute que des procès liés à l’action de Siemens sont en cours en Grèce, depuis septembre 2017, avec le renvoi devant la justice de 18 cadres de Siemens (dont Christoforakos), en Grèce et en Allemagne, pour corruption d’agents de l’État « non identifiés ». Les agendas de Christoforakos livrés par son ancienne secrétaire montrent qu’il a eu des rencontres répétées avec certaines des principales figures politiques de la Nouvelle Démocratie et du Pasok, afin de leur remettre des commissions en nature.
|9| Elle a pris l’initiative d’élaborer la seule mesure qui combattait les effets létaux de l’austérité mémorandaire sur l’économie réelle, avec la possibilité d’éponger en 100 versements les dettes d’impôts des particuliers et des entreprises. Voir cet article
|10| Dégager un excédent primaire du budget implique généralement de comprimer les dépenses qui ne concernent pas le remboursement de la dette de manière à ce que les recettes (rentrées) soient supérieures aux dépenses (sorties). L’excédent primaire est donc calculé sans prendre en compte le remboursement de la dette publique. Une fois que ce paiement est pris en compte le budget est en déficit et il faut recourir à de nouveaux emprunts pour tenir la route.
|11| Le gouvernement Tsipras espérait également pouvoir compter sur la somme de 11 milliards qui constituait le solde du montant alloué à la recapitalisation des banques et que Syriza voulait rediriger vers la création d’une banque de développement et le renforcement du secteur public. Extrait du programme de Thessalonique : « En ce qui concerne le coût du capital de départ du secteur public, du vecteur intermédiaire et de banques spécialisées – estimé à 3 milliards d’euros –, il sera financé par le soutien de 11 milliards d’euros prévu pour les banques par le mécanisme de stabilité ».
|12| Stathis Kouvélakis témoigne du sentiment qu’un changement fondamental était en cours : « le discours de politique générale de Tsipras au Parlement le 8 février a été un moment extrêmement important. Il se situe après les ruptures symboliques, au moment de la prise de fonction du nouveau gouvernement, avec le serment civil, avec la gerbe de fleurs déposée à Kaisariani sur le monument aux deux cents héros communistes de la Résistance exécutés par les nazis le 1er mai 1940. Il faut rappeler que ces deux cents cadres communistes exécutés, c’était toute la direction du parti… Ce geste a inscrit ce gouvernement dans un fil historique puissant, dans l’histoire profonde du mouvement populaire et de la gauche communiste en Grèce. Et là, lors du discours de politique générale, on a pu sentir que la rupture était à nouveau vraiment à portée de main. » (Stathis Kouvélakis, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale. Entretiens avec Alexis Cukier, La Dispute, Paris, 2015, p. 17-18). Bien sûr, différentes organisations de gauche n’ont pas manqué d’attaquer ou de critiquer durement Tsipras : il s’agissait du KKE, le parti communiste grec très sectaire, et des organisations de la gauche extraparlementaire que ce soit celles regroupées dans Antarsya, ou des groupes anarchistes qui ont occupé des locaux de Syriza rapidement après la constitution du gouvernement.
|13| Éric Toussaint, « Comment appliquer des politiques antipopulaires d’austérité ; L’OCDE fournit un vade-mecum pour les gouvernants »
|14| En effet, il n’y a pas d’autre interprétation possible car prolonger le mémorandum en vigueur impliquait automatiquement que les partenaires ne changent pas. Donc le fait d’insister sur la présence du FMI ne pouvait concerner dans la tête de Berlin qu’un troisième mémorandum à signer à l’issue du prolongement de celui qui était en cours. C’est d’ailleurs ce que Berlin a obtenu en juillet 2015.
|15| C’est Varoufakis qui souligne ce passage.
|16| Souligné par l’auteur.
|17| Le texte original en anglais est consultable sur ce site. Les extraits cités proviennent de la traduction réalisée à chaud par Ananda Cotentin
|18| Souligné par l’auteur
|19| Stathis Kouvélakis, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale. Entretiens avec Alexis Cukier, La Dispute, Paris, 2015, p. 76-77)
Source http://www.cadtm.org/Varoufakis-Tsipras-vers-l-accord