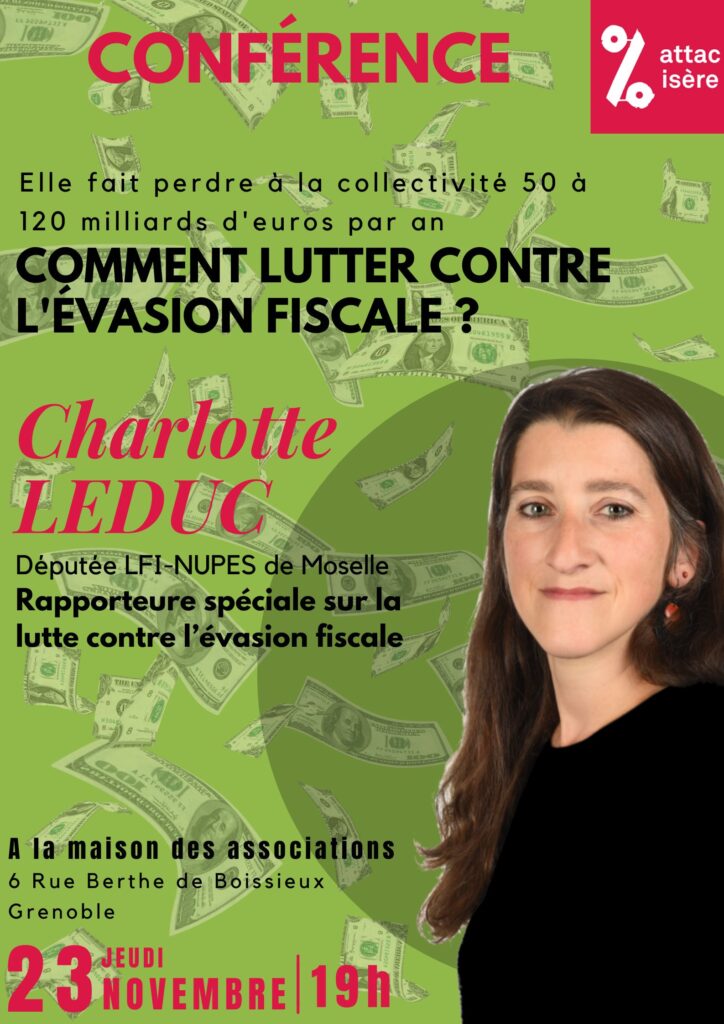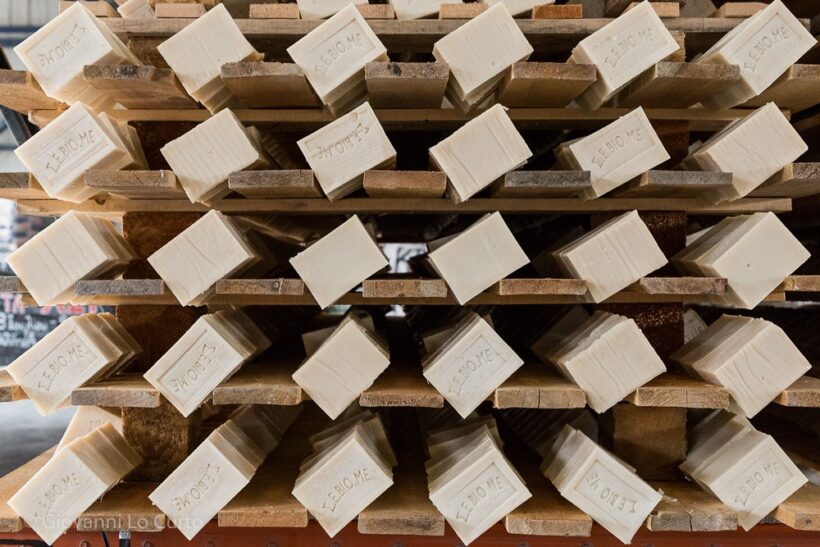Par Stathis Kouvélakis
Syriza traverse actuellement ce qui pourrait bien être sa crise finale après l’élection à sa tête d’un ancien trader : Stefanos Kasselakis. Celui-ci a pris la succession d’Alexis Tsipras après la déroute électorale récente du parti, en bénéficiant d’un large soutien des médias dominants et d’un système de « primaire interne » qui permet à toute personne s’inscrivant en ligne et payant la somme de deux euros de participer à l’élection du chef du parti.
Stathis Kouvélakis analyse dans cet article ce qui apparaît d’ores et déjà comme la « deuxième mort » de Syriza, la première renvoyant à la capitulation en rase campagne de l’été 2015 face à la Troïka (Banque centrale européenne, Fonds monétaire international et Commission européenne). Celle-ci conduisit Tsipras à mener une politique d’une extrême brutalité pour les classes populaires et, ainsi, à transformer Syriza de parti de la gauche radicale en parti de l’austérité néolibérale.
***
On connait sans doute les phrases par lesquelles commence le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte de Marx : « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages de l’histoire surgissent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».
Ce « quelque part » fait référence à un passage des Leçons sur la philosophie de l’histoire qui établit un parallèle, d’une part, entre le passage de Rome de la république à l’empire et celui de la France de la monarchie à la république, et, de l’autre, entre le destin de César, celui de Napoléon et celui de la dynastie des Bourbons. Selon Hegel, le meurtre de César est censé ramener la république, en mettant fin au pouvoir personnel, mais il aboutit à sa fin irrévocable et à l’instauration du régime impérial, d’un césarisme sans César que le meurtre de celui-ci a rendu possible. Napoléon et les Bourbons sont chassés deux fois du pouvoir, et ce n’est qu’au terme de cette réitération que l’irréversibilité de la fin du pouvoir qu’ils ont incarné est véritablement actée.
Hegel en tire une sorte de loi de l’histoire selon laquelle « la répétition réalise et confirme ce qui au début paraissait seulement contingent et possible »[1]. Un événement n’est définitivement enregistré que lorsque, par sa répétition, sa nécessité, c’est-à-dire son caractère irréversible, est reconnue. Cette répétition n’est en fait jamais une répétition à l’identique, elle s’effectue toujours sous une forme déplacée.
Toutefois, l’idée d’un passage de la tragédie à la farce est, pace Marx, déjà bien présente chez Hegel, qui caractérise la « Restauration » des Bourbons de « farce qui a duré 15 ans »[2]. La normalité propre à l’ère bourgeoise tend à refouler les moments troubles qui ont scandé son émergence. Pour autant, si toute idée de retour en arrière s’avère illusoire, cette illusion fait elle-même partie du processus qui, par le jeu de la répétition, enregistre la césure de l’événement.
Le désastre que vit la Grèce, et en particulier la gauche grecque, depuis le terrible été 2015 apparaît comme un cas d’école de cette « ruse de la raison historique ».
Entre les deux morts, la séquence 2015-2023
La dernière en date des tragédies d’un pays qui en a connu bien d’autres est donc survenue en ce terrible été 2015, lorsqu’Alexis Tsipras capitule en rase campagne face à la Troïka (Union européenne, Banque centrale européenne, Fond Monétaire International), et accepte un plan néolibéral de choc (connu en tant que « 3e Mémorandum ») bien pire que celui que l’électorat grec venait de rejeter quelques jours auparavant, lors du référendum du 5 juillet. Mais l’ampleur de la catastrophe était telle qu’elle fit l’objet d’un déni, habilement cultivé par Tsipras et ceux qui l’ont suivi au sein de son parti, avec l’appui enthousiaste des classes dominantes grecque et européennes.
Syriza a pu ainsi remporter le scrutin anticipé de septembre 2015 en laissant croire que l’acceptation du 3e Mémorandum n’était qu’un recul tactique et en promettant de mettre en œuvre un « programme parallèle », censé neutraliser ses retombées négatives. Les quatre ans qui ont suivi ont toutefois été marqués par l’application à la lettre des recettes néolibérales draconiennes gravées dans le marbre de cet accord, sans la moindre mesure compensatoire, transformant la Grèce en pays modèle du néolibéralisme au sein de l’UE.
L’électorat sanctionne lourdement Syriza au scrutin européen de mai 2019, en le plaçant (à 23,7% contre 35,6% en septembre 2015), dix points derrière une droite revigorée, assurée de revenir au pouvoir. Sentant le vent du boulet, Tsipras bouscule de quelques mois le calendrier électoral et appelle à un scrutin législatif anticipé pour juillet. La manœuvre porte ses fruits, ou du moins quelques-uns.
Certes, Syriza sort perdant, à près de neuf points derrière Nouvelle Démocratie. Mais il progresse de près de huit points par rapport aux européennes, atteignant un score inespéré de 31,5%. La perspective d’un retour de la droite au pouvoir a suscité un ultime réflexe de vote-barrage. Ce réflexe s’était nourri de la réaction suscitée par les manifestations nationalistes du printemps précédent contre l’accord signé avec la République de Macédoine du Nord, qui avaient vu se constituer un front commun entre l’extrême droite et les secteurs les plus radicaux de Nouvelle Démocratie.
Ce score a créé l’illusion, propagée conjointement par Syriza et le système politico-médiatique, selon laquelle on assisterait au retour à un système bipartisan comme celui que le pays avait connu des années 1970 à la crise de 2010. A la seule différence que c’était désormais le parti d’Alexis Tsipras qui était censé occuper la place qui fut naguère celle du Pasok, celle d’une force d’alternance gouvernementale face à la droite.
Cette illusion renvoyait de fait à une autre, plus profonde : celle qui refusait d’admettre le caractère irréversible de ce qui s’était passé l’été 2015, et qui s’était prolongé lors des quatre années qui avaient suivi, à savoir la mutation de Syriza d’un parti de la gauche radicale en véhicule d’une forme particulièrement dévastatrice de néolibéralisme, assortie d’une mise sous tutelle du pays pendant plusieurs décennies[3].
Mai-juin 2023 : le naufrage électoral
L’effondrement électoral de Syriza au scrutin de mai 2023, confirmé et aggravé dans celui qui a suivi (de 31,5% en 2019 à 20% en mai puis à 17,8% en juin), a mis fin à cette illusion. Au cours des quatre années précédentes, Syriza s’était contenté de mener une opposition superficielle, ne contestant aucune orientation de fond de la droite.
Au parlement, ses députés ont voté 45% des lois proposées par le gouvernement de Mitsotakis, y compris les plus emblématiques comme celle autorisant la vente à un prix symbolique du terrain de l’ancien aéroport d’Elliniko à l’oligarque Yanis Latsis, associé à des capitaux qataris, ou les pharaoniques contrats d’armement, d’un montant de près de 15 milliards à ce jour, qui ont conduit au doublement du budget de la défense entre 2020 et 2022. Syriza s’est chargé lui-même de rappeler quotidiennement que la capitulation de 2015 et son mandat gouvernemental ne constituaient en rien une « parenthèse » forcée mais bien une rupture qui n’admettait aucun retour en arrière.
Par ailleurs, Tsipras a engagé une mutation de la structure organisationnelle de Syriza en ouvrant largement le parti à des personnalités « centristes », en général issues du Pasok, qui avaient approuvé tous les Mémorandums signés avec la Troïka lors de la période 2010-2015. Le nom du parti a été modifié en 2020 en « Syriza-Alliance progressiste », avec l’ambition d’en faire une force capable de couvrir l’espace du « centre-gauche » et d’apparaître comme une force d’alternance stable. Et, surtout, Tsipras a instauré en 2022 un système de « primaire interne », ouverte à toute personne s’inscrivant en ligne et payant la somme de deux euros.
Seul candidat, Tsipras est élu président du parti par une « base » fictive de 170 mille personnes – jusqu’à l’été 2015 Syriza comptabilisait 35 000 membres, mais il s’agissait alors de vrais membres affiliés à une section locale ou d’entreprise. A la tête d’un parti vidé de toute substance militante et transformé en machine électorale au service du leader, Tsipras pensait aborder avec une relative sérénité les scrutins de 2023. L’objectif était sinon de gagner une majorité, du moins être en mesure de constituer une coalition gouvernementale « progressiste » avec le Pasok et accoucher ainsi d’un pôle de centre-gauche sur le modèle du PD italien.
Dans ce contexte, la double déroute de mai et juin 2023, la seconde amplifiant la première, a provoqué un séisme interne. Dans une ambiance lugubre, Tsipras démissionne quelques jours après la gifle électorale de juin. Il laisse un parti démoralisé et, surtout, dépourvu d’identité et de repères autres que le culte du leader et l’obsession de revenir au pouvoir.
De nouvelles « primaires » sont convoquées pour septembre, et une proche de Tsipras, Efi Achtsioglou, se présente comme la successeure désignée, bénéficiant de l’appui de l’appareil. Elle fait partie du groupe de quadras qui ont accédé à la notoriété en occupant d’importants portefeuilles ministériels entre 2015 et 2019. Elle-même, en tant que ministre du travail, a lié son nom à deux lois qui restreignent drastiquement le droit de grève (désormais soumis à un vote préalable des membres du syndicat, sur le modèle des lois Thatcher) et suppriment les négociations tripartites (syndicats-patronat-Etat) sur le SMIG, désormais fixé par décret.
Tout paraissait joué, jusqu’à ce qu’un outsider absolu, Stefanos Kasselakis se déclare candidat à la fin août et remporte aisément le scrutin (qui s’est déroulé en deux tours, selon les règles fixées en 2022). Que s’est-il passé ?
Qui est Stefanos Kasselakis ?
Dans les conditions actuelles d’affaiblissement au niveau mondial des partis politiques, le succès d’un outsider comme Kasselakis pourrait paraître trivial. Il l’est toutefois moins si on prend en compte ce qui fait la singularité du personnage et de son ascension éclair sur la scène politique. L’originalité du cas consiste en ce que l’outsider en question ne fonde pas une nouvelle formation, par-delà les clivages établis du champ politique, mais, défiant toute prévision, parvient à s’imposer à la tête d’un parti héritier d’un courant historique de la gauche et qui, malgré son affaiblissement, reste la principale force d’opposition au parlement grec.
A première vue, le succès de Kasselakis se présente comme une simple combinaison des techniques de com qui font l’essence de la « post-politique » actuelle. Jeune, riche, sportif, ouvertement gay (mais sans promouvoir d’agenda LGBT+ particulier), Kasselakis paraît incarner lui-même l’« image » de nouveauté, celle du « rêve grec » qu’il promet à ses partisans. La campagne-éclair qui l’amène à la présidence de Syriza est entièrement basée sur des petites vidéos (six, soit un total 43 minutes), de rares interviews (il arrête rapidement un exercice qui le met en difficulté), et, avant tout, sur le recours intensif aux réseaux sociaux.
Le candidat-surprise est aussitôt adoubé par les médias audiovisuels, qui lui assurent une visibilité extraordinaire, entièrement basée sur l’étalage complaisant de son style de vie (son chien, son mari, sa salle de fitness, ses sorties etc.). Son discours est à l’image de sa campagne : il se présente comme un visage neuf, « l’homme capable de battre Mitsotakis », dégagé de tout « boulet idéologique » à l’opposé des « hommes (et femmes) d’appareil » qu’il affronte dans le cadre des primaires de Syriza.
Lors des interviews, son ignorance des sujets les plus élémentaires de la politique grecque est flagrante. Malgré son succès supposé dans le monde des affaires, il semble ignorer le montant du taux d’imposition des sociétés en Grèce et, nonobstant les saillies « patriotiques » dont il parsème ses discours, il n’a qu’une vague idée des problèmes qu’affronte le pays dans ses rapports avec la Turquie. Ses propositions sont aussi floues que sommaires, mais toutes s’insèrent dans la grammaire néolibérale : moins d’impôts, suppression du service militaire obligatoire et promotion d’une armée de métier, « égalité des chances » et « rêve grec pour tous ».
Peu après son élection à la présidence du parti, il prononce devant l’assemblée générale annuelle du patronat grec un discours remarqué, qui dissipe le nuage de fumée qui a entouré sa campagne. Il y défend une vision qui « ne diabolise pas le capital et le voit comme un outil pour la prospérité, pour la réduction des inégalités à travers une croissance forte ». Selon cette version de la « théorie du ruissellement », le « mot travail doit être un appel à la ‘collaboration’, pour un nouveau contrat social par lequel les travailleurs participent activement à la croissance de l’entreprise ».
La clé du succès de Kasselakis se trouve sans doute dans cette adéquation entre un discours à peu près vide de contenu, au sens où il se contente de surfer sur les clichés (au sens imagé) du néolibéralisme, et son incarnation dans un visage juvénile, dépourvu de toute épaisseur, donc entièrement modelable (et modelé) par les techniques de la com. Il apparaît comme la transposition dans le champ de la politique de la figure de l’« ambianceur », pour reprendre une catégorie de Nicolas Vieillescazes : quelqu’un qui diffuse une certaine vision, en l’occurrence néolibérale, mais de façon vague, quasiment subreptice, qui évite toute affirmation et propos « clivant » et se fond ainsi dans l’ « ambiance » régnante, puissamment aidé en cela par son (apparente) absence de passé. Davantage qu’une véritable singularité, Kasselakis apparaît comme un produit d’algorithmes, simple figuration de la logique anonyme du système politique et de l’ordre social dont il est l’expression.
Si Kasselakis a pu s’en tenir pendant sa courte campagne pour la présidence de Syriza (à peine plus de deux semaines) à un discours infra-politique, c’est qu’il est lui-même un inconnu à peu près complet non seulement sur la scène politique mais aussi dans la vie publique du pays. Sa désignation par Alexis Tsipras sur les listes de Syriza (dans une position non-éligible) aux scrutins de mai et juin 2023 au titre de personnalité de la diaspora[4] est passée à peu près inaperçue.
Ayant quitté la Grèce à l’âge de 14 ans, il est résident permanent aux Etats-Unis jusqu’au début de l’année dernière. C’est dans ce pays que s’est déroulée la totalité de sa carrière professionnelle, qui l’a vu passer du statut de trader de la Goldman Sachs à celui d’armateur, une trajectoire qui lui donne l’aura du self-made man dont il ne cesse de se prévaloir. Pourtant, un voile d’opacité entoure la nature exacte de ses activités entrepreneuriales.
De récents reportages de la presse grecque pointent une structure labyrinthique de sociétés au statut juridique complexe, dont les principales sont basées au Delaware, un Etat de la côte Est des Etats-Unis connu pour son statut de paradis fiscal et pour la règle de confidentialité qu’il applique quant à la propriété des sociétés qui y sont enregistrées. Tout cela au mépris de la législation grecque qui interdit aux élu.es et aux dirigeant.es de partis représentés au parlement d’être propriétaires de sociétés dont le siège se trouve hors du pays.
Même le passage par la Goldman Sachs est controversé : Kasselakis aurait été licencié pour « performance insuffisante », alors que lui-même assure l’avoir quittée de son propre gré pour reprendre des études supérieures. De même, il apparaît que, loin d’être le self-made man qu’il prétend, son entrée dans le monde des affaires s’est effectuée grâce à l’appui de la société de son père et à celui du puissant armateur Marcos Nomikos.
Que sa trajectoire ait été celle d’un capitaine ou, plus vraisemblablement, celle d’un chevalier d’industrie, Kasselakis n’est pas un inconnu au sein de la communauté gréco-étatsunienne. Il a tenu pendant des années une chronique consacrée à l’économie dans son organe emblématique, The National Herald, un quotidien ultra-conservateur (et soutien notoire de la dictature des colonels qui a sévi de 1967 à 1974) mais qui entretient de puissants liens « bipartisans » avec l’establishment politique et économique étatsunien. Kasselakis y publie ses chroniques parfois sous son nom, parfois sous le pseudo d’Aristotelis Oikonomou, en hommage à l’armateur mythique Aristotelis Onassis.
La presse grecque a abondamment fait état de ses publications passées, qui ne laissent aucun doute sur son positionnement idéologique et politique – même si l’effet de ces révélations a été habilement neutralisé par le tapage communicationnel qui a entouré sa campagne. Tout au long de la crise des années 2010-2015, Kasselakis a vigoureusement défendu la thérapie de choc de la Troïka, jugeant que les salaires grecs sont trop élevés (y compris le salaire minimum), et que les licenciements de fonctionnaires et les coupes dans les services publics imposés par la thérapie de choc étaient « insuffisants ».
Il proposait comme modèle la politique économique de Reagan et la création d’universités privées. Il considérait Syriza, et en particulier Alexis Tsipras, comme un « danger » pour le pays comparable à celui que Trump représentait pour les Etats-Unis (lui-même était pourtant enregistré comme électeur républicain à New York de 2013 à 2019). Il avait affiché, en 2015, son soutien à l’actuel premier ministre Konstantinos Mitsotakis lors des primaires de la droite et salué, en 2019, la victoire de Nouvelle Démocratie (dirigée par Mitsotakis), lorsqu’elle succède au pouvoir à Syriza.
Dans un entretien accordé en juillet 2023 à l’édition en langue anglaise du quotidien athénien Kathimerini, alors qu’il s’était déjà présenté comme candidat sur les listes de Syriza, il se targue de « son excellente relation avec Mitsotakis, qui date de 2012, quand il était simplement député ». Dans le même entretien, il déclare avoir accepté la proposition de Tsipras de figurer sur les listes de son parti car il « pense qu’avec lui (Tsipras) nous pourrions créer l’équivalent grec du Parti Démocrate [étatsunien], qui pourrait mettre en œuvre un ensemble de changements politiques allant de projets de loi bipartisans sur l’économie et la réforme de la justice à des protections progressistes sur les droits de l’homme, le logement, la pauvreté, etc. ».
L’aboutissement d’un long délitement
L’élection d’une telle personnalité à la tête d’un parti comme Syriza, qui compte 20 ans d’existence et plonge ses racines dans l’histoire mouvementée de la gauche communiste grecque, a bien quelque chose de vertigineux. De la tragédie on est effectivement passé à la farce, mais le spectacle a continué à attirer des spectateurs. Il s’est en effet trouvé 70 mille personnes pour soutenir Kasselakis lors du second tour des primaires (56% du total) contre 56 mille à sa rivale, Efi Achtsioglou. Comment expliquer cette adhésion ?
Il faut tout d’abord mentionner la déstructuration idéologique profonde induite par le cynisme impudent d’une formation de la « gauche radicale » qui renie ses engagements fondamentaux, bafoue le résultat d’un référendum qu’elle a elle-même organisé, et s’accroche au pouvoir pour poursuivre la politique néolibérale d’une grande brutalité engagée par ses prédécesseurs. La perte de repères qui s’ensuit nourrit le nihilisme et les mues les plus improbables, y compris au sein de ce qui restait de l’électorat de Syriza.
Vient ensuite l’impact de la procédure de la primaire qui substitue au principe d’un parti constitué de militants souverains celui d’un agrégat anonyme et atomisé, constitué de membres fantômes à deux euros, aisément manipulable par les médias et le buzz des réseaux sociaux. Sans la figure de Tsipras, qui maintenait l’apparence d’une continuité, le parti centré autour de son leader est apparu pour ce qu’il était devenu : une coquille vide.
Avec ce mélange d’inconscience et de sincérité qui caractérise les outsiders, Kasselakis a déclaré que « si Syriza fonctionnait correctement, s’il avait une base sociale, une réserve de cadres et de jeunes, il y aurait évidemment quelqu’un d’autre qui aurait pris la place que j’occupe aujourd’hui. Le fait que j’aie été élu n’est pas un signe de bon fonctionnement. Je l’admets. Si j’ai été élu, c’est parce que les gens voulaient quelque chose de différent ».
Toutefois, la victoire d’un candidat aussi improbable n’a été possible que du fait du discrédit de ses concurrents. Usés par un exercice du pouvoir impopulaire, ayant appliqué sans broncher des politiques néolibérales aux antipodes complets des engagements de Syriza, ils et elles en ont payé le prix lorsque le désastre électoral est survenu. Incarnant la continuité et une forme de légitimité « partidaire », Efi Achtsioglou en particulier pensait que les primaires seraient une promenade et menait une campagne routinière et « centriste ».
C’est précisément ce qui l’a conduit à la défaite : brocardée en tant que représentante d’une ligne et d’une équipe qui avait échoué, elle n’avait pas grand-chose à opposer à la « guerre-éclair » communicationnelle d’un Kasselakis, avec son profil d’« homme neuf », vierge de tout lien avec le Syriza de gouvernement, adossé au système médiatique mais bénéficiant également de la bienveillance implicite de Tsipras. Sa défense de « l’identité de gauche » du parti ne pouvait qu’apparaître que comme le reliquat démonétisé d’une époque révolue.
La force de Kasselakis a été précisément d’affirmer la rupture avec une identité devenue sans objet. Une fois de plus, l’injonction que le « révisionniste » Eduard Bernstein lançait à la socialdémocratie allemande à la fin du 19e siècle – « qu’elle ose paraître ce qu’elle est » – a fait la preuve de son efficacité. Profitant du désarroi créé par la déroute électorale, le candidat surprise a su mobiliser les procédures mises en place par Tsipras pour construire une base de supporters à partir des technologies qu’appellent ces mêmes procédures : le buzz des réseaux sociaux et le tapage médiatique.
Son succès illustre ce que Gramsci appelait un processus déjà bien avancé de « transformisme » et dont la racine n’est pas à chercher ailleurs que dans la capitulation de l’été 2015. C’est aussi la raison pour laquelle son OPA sur Syriza a bénéficié, dans un premier temps (mais qui était le plus crucial), de la bienveillance de Tsipras et du soutien de ses plus proches collaborateurs au sein du cercle dirigeant.
Syriza sous le leadership de Kasselakis
Si l’on appliquait à Kasselakis les critères dont il se réclame lui-même, le bilan de ses six premiers mois à la présidence du parti est pour le moins décevant, si ce n’est catastrophique. Les élections régionales et municipales d’octobre dernier ont été une humiliation pour le parti, qui a perdu le peu de bases municipales qui lui restaient.
Presque partout il a été dépassé par le Pasok, qui a remporté un succès spectaculaire et inattendu en délogeant (au second tour) la droite de la municipalité d’Athènes, l’ex-maire n’étant autre que le neveu du premier ministre Mitsotakis. Pire, Syriza est talonné au niveau national par le Parti communiste, qui connaît un redressement sensible et contrôle actuellement cinq municipalités importantes, dont celle de Patras, 3e ville du pays (conquise en 2014). Suite à ce premier test électoral, Syriza est relégué en 3e position (autour du 12%) dans la quasi-totalité des sondages, à deux points en moyenne derrière le Pasok.
Ce qui a fait la une des médias au cours des mois qui ont suivi, ce ne sont plus tant les opérations de com’ de son président (malgré la publicité accordée à l’anniversaire de son chien Farly…) mais les déboires internes du parti et les révélations sur ses activités professionnelles aux Etats-Unis. Son élection a été suivie de vagues de départ de Syriza (pendant plusieurs semaines, la presse publiait quasi-quotidiennement des lettres collectives de départ signées par des dizaines, parfois des centaines de membres), des exclusions de députés, et rapidement, par le départ des principaux courants « historiques » : « Parapluie », qui se voulait l’aile gauche du parti (son candidat, Euclide Tsakalotos, ancien ministre de l’économie et des finances, avait recueilli 8,3% des voix lors du 1er tour des primaires), et le groupe dit « 6+6 », qui regroupe les quadras de l’ancienne direction autour de Tsipras, dont la candidate, Efi Achtsioglou, a affronté Kasselakis lors du second tour des primaires (elle avait obtenu 36% lors du premier).
Ces deux courants ont d’abord créé un groupe parlementaire, avec 11 députés sur les 47 élus sous l’étiquette Syriza en juin 2023, puis un parti nommé « Nouvelle Gauche ». Celui-ci a tenu sa première conférence nationale début mars et élu à sa tête Alexis Charitsis (47 ans), qui a détenu divers portefeuilles dans les gouvernements Tsipras.
Bien que se voulant garante de l’« identité de gauche », qu’elle accuse Kasselakis d’avoir abandonnée, Nouvelle Gauche se veut également la meilleure défenseure du bilan gouvernemental de Syriza, auquel ses principaux dirigeants restent associés. L’argument est que la cause de la crise du parti remonte à 2019. Seraient en cause l’incapacité à mener une opposition crédible et la politique d’« ouverture vers le centre » impulsée par Tsipras, ainsi que la transformation de l’organisation en machine au service du leader. La capitulation de 2015 et les quatre années de politiques néolibérales drastiques qui ont suivies font l’objet d’un non-dit, si ce n’est d’un déni. La proposition politique de Nouvelle Gauche revient en fin de compte à entretenir l’illusion d’un possible « tsiprisme sans Tsipras », dans la continuité du « Syriza de gouvernement » des années 2015-2019.
Par contraste, le Syriza de l’ère Kasselakis joue une carte de distanciation partielle avec le bilan du Syriza au pouvoir. Flirtant avec une rhétorique populiste, il dénonce certains aspects de la politique de la période 2015-2019 qui ont particulièrement affecté les couches moyennes (surtaxation des professions libérales et des indépendants) ou les retraités. Naviguant au gré des sondages et des trouvailles des communicants, le « progressisme » du « nouveau » Syriza offre une combinaison de platitudes néolibérales agrémentées d’une pincée de populisme.
Parmi les principaux appuis de l’actuel président issus de l’ancien Syriza, on trouve Pavlos Polakis, ancien ministre de la santé. Personnage histrionesque maniant constamment l’insulte sur les réseaux sociaux , il y relaie l’argumentation des antivax ainsi que des propos nationalistes et xénophobes, frisant parfois le racisme. De son côté, Kasselakis ne manque jamais une occasion de mettre en avant son « patriotisme » et d’affirmer son soutien aux montants astronomiques des dépenses militaires engagées par le gouvernement actuel (que Syriza a par ailleurs toujours soutenues au parlement).
Le 4e congrès de Syriza, qui s’est tenu fin février, a été marqué par l’intervention de dernière minute de Tsipras au moyen d’une lettre rendue publique la veille de son ouverture. Quelques jours auparavant, Kasselakis avait adressé aux « membres » un « questionnaire en ligne » qui remettait en cause l’ensemble des « fondamentaux » de Syriza : nom et emblème du parti, positionnement dans l’axe droite-gauche, nécessité de « changements radicaux » dans sa structure.
Ce questionnaire a suscité la réaction de la quasi-totalité des anciens « barons » du parti et forcé Tsipras à intervenir. Dans une ultime tentative d’affirmer son influence au sein du parti, Tsipras dénonce à la fois ceux qui l’ont quitté pour créer Nouvelle Gauche et le leadership de Kasselakis, à qui il reproche d’avoir été élu sans avoir ouvert ses cartes. Il lui demande en conséquence de procéder à des nouvelles élections pour la présidence du parti, faisant ainsi monter d’un cran le niveau, déjà très élevé, de tension interne.
Le congrès lui-même a donné une image de chaos indescriptible, la plupart des participant.es n’étant pas des délégué.es élu.es (les sections se trouvant dans l’incapacité de tenir des réunions) mais une masse de supporters du nouveau leader, huant systématiquement les opposant.es dans une ambiance digne des jeux de cirque romain. Malgré l’annonce d’une candidature opposée à Kasselakis (celle d’Olga Gerovassili, un profil comparable à celui d’Achtsioglou en plus âgé), le congrès a repoussé in fine la proposition de tenue de nouvelles élections dans une caricature de délibération. Les médias ont abondamment parlé de farce, et comparé le congrès aux spectacles satiriques kitsch de la scène populaire du Pirée Delphinario.
Pourtant, que ce soit en termes d’image personnelle ou de stratégie, Kasselakis sort incontestablement renforcé de l’épreuve : débarrassé de toute opposition interne, il a rompu le lien symbolique avec Tsipras et mis un terme à toute velléité de son ancien leader d’interférer dans les affaires du parti. Il a désormais carte blanche pour mener au bout sa transformation de Syriza en parti libéral à l’américaine. Ses premières décisions ont consisté à mettre en place un schéma d’organisation d’inspiration explicitement entrepreneuriale : le parti est géré par son président, entouré de son staff et de plusieurs « think tank » thématiques.
Le projet de changement de nom n’est que reporté, sans doute pour le lendemain du scrutin de juin prochain. Reste à savoir si cette opération est en mesure d’améliorer la performance électorale, qui s’annonce calamiteuse, aux élections européennes. Les derniers sondages indiquent certes un léger redressement, et redonne à Syriza la deuxième place, légèrement devant le Pasok, mais à plus de vingt points derrière Nouvelle Démocratie et toujours sensiblement en-deçà du score de juin 2013.
Même si lui-même s’en défend, et réclame à être jugé en fonction du résultat lors du prochain scrutin législatif (prévu pour 2027), le leadership de Kasselakis apparaît fragile. Mais on peut d’ores et déjà affirmer que sa mission historique est accomplie : la deuxième mort de Syriza est maintenant un fait accompli. Le passage de la tragédie à la farce laisse derrière lui une gauche exsangue et une société déboussolée, à la merci de démagogues sans scrupules, qui ne cachent même plus leurs liens avec les puissances d’argent.
*
Notes
[1] G. W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1979, p. 242.
[2] Ibid., p. 343.
[3] Les engagements en matière d’excédents budgétaires, de remboursement de la dette et de mise sous hypothèque du patrimoine public de la Grèce contractés en 2018 par le gouvernement Tsipras, lors de l’accord de « sortie » du 3e Mémorandum, courent jusqu’en 2060. Par ailleurs, le Trésor public de la Grèce, tout comme l’Institut de statistiques, sont devenus des autorités « indépendantes », placées sous le contrôle indirect de l’Union européenne.
[4] Les partis grecs sont tenus d’inclure un quota de candidat.e.s de la diaspora depuis que le vote a été accordé, sous des conditions très restrictives, aux résident.e.s à l’étranger.
Source https://www.contretemps.