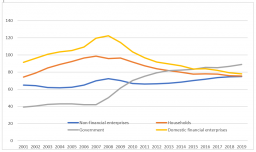Dans cet article, Alain Bihr cherche à penser la situation socio-politique qui pourrait succéder à la crise sanitaire. Il formule et développe trois scénarios possibles, qui dessine des futurs très différents : la perpétuation et l’approfondissement du néolibéralisme et de ses contradictions ; un tournant néo-social démocrate ; l’ouverture de brèches en vue d’une rupture révolutionnaire.
***
La crise déclenchée par la pandémie de Covid-19 présente un caractère doublement global : elle est à la fois mondiale et multidimensionnelle (non seulement sanitaire mais aussi économique, sociale, politique, idéologique, psychique, etc.). A ce double titre, elle déstabilise gravement le pouvoir capitaliste dans ses différentes composantes, en le mettant au défi de se renouveler, en inventant et développant de nouvelles modalités au-delà de la réinstauration des anciennes mises à mal.
Du même coup, cette crise constitue aussi un défi lancé à toutes les forces anticapitalistes, lui aussi double. Défensivement, il doit anticiper sur la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de domination capitaliste tout en cherchant, offensivement, à tirer profit de l’affaiblissement conjoncturel du pouvoir capitaliste pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur, voire ouvrir des brèches susceptibles de s’élargir sur des perspectives révolutionnaires.
Les lignes qui suivent n’ont d’autre ambition que d’exposer quelques thèses concernant l’un et l’autre de ces deux aspects de la crise et de contribuer ainsi à la discussion qui s’est déjà amorcée à ce sujet dans les rangs anticapitalistes[1]
*
1. C’est au niveau de ses instances gouvernementales que le pouvoir capitaliste s’est trouvé déstabilisé de la manière la plus évidente par la pandémie et la crise sanitaire qui s’en est suivie. Le déni d’abord[2], la procrastination ensuite, les demi-mesures pour continuer, transformant une nécessité créée de toutes pièces (car dictée par l’état déplorable d’un appareil sanitaire affaibli par des décennies de restrictions budgétaires, ordonnées aux politiques néolibérales, en dépit des alertes et mobilisations des personnels soignants) en une vertu mensongère (le dépistage systématique serait inutile, les masques de protection ne serviraient à rien, etc.) et, enfin, un amateurisme ubuesque dans leur exécution, qui ferait rire en d’autres circonstances, ont gravement compromis le crédit de l’immense majorité des gouvernants. Et ce, même lorsque l’imbécillité ignare (comme dans le cas d’un Donald Trump, d’un Andrés Manuel Lopez Obrador ou d’un Jair Bolsonaro) ou le cynisme néodarwiniste inspirant la thèse de l’immunité de groupe (comme dans le cas d’un Boris Johnson, d’un Mark Rutte[3] ou d’un Stefan Löfven[4]) n’y ont pas rajouté une couche d’ignominie criminelle.
Il est désormais évident pour une majeure partie des populations qui ont eu à en subir les conséquences que ces gouvernants sont prêts à tout pour masquer leur impéritie, leur absence de prise sur des événements, surtout leur responsabilité dans l’insuffisance notoire de la capacité de réaction d’un appareil sanitaire qu’ils ont sciemment affaibli, au prix de mensonges redoublés que leur redoublement même finit par trahir. C’est à six reprises, pas moins, que, lors de son allocution du 16 mars, Emmanuel Macron a répété que « nous sommes en guerre ». Le recours à cette métaphore abusive devrait nous alerter. C’est le moment de se souvenir qu’« on ne ment jamais autant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse », selon un bon mot de Georges Clémenceau, un fin connaisseur dans cette triple matière. Et, comme Clausewitz nous l’a appris, la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens : en l’occurrence, en cherchant à aggraver la panique engendrée par la pandémie, il s’agit de provoquer le réflexe d’unité nationale, voire d’« Union sacrée », propre à regrouper le peuple apeuré autour du chef des armées et de son État, en dénonçant par avance toute critique comme une haute trahison.
Ont cependant fait exception les gouvernements de la Corée du Sud, de Taïwan, de Hongkong et de Singapour qui ont, d’emblée, mis en œuvre la seule stratégie efficace de lutte contre la diffusion du Covid-19 à base de dépistage de tous les cas suspects, de confinement et traitement des seules personnes infectées et de celles qui les ont approchées et qui ont pu être identifiées, de port obligatoire de masques et de tracking dans l’espace public pour toutes les autres[5]. Encore fallait-il disposer du matériel, du personnel et des infrastructures appropriés à ces fins (sans compter une bonne dose de discipline collective), qui faisaient précisément défaut dans les cas précédemment mentionnés, pour les raisons que l’on sait.
*
2. C’est cependant bien plus profondément que dans les seules sphères gouvernementales que le pouvoir capitaliste se trouve aujourd’hui ébranlé. Ce sont en fait les bases mêmes de la production capitaliste qui se trouvent mises en cause, tant ses exigences les plus immédiates et les formes qu’elles ont prises durant ces dernières décennies que la dynamique proprement infernale dans laquelle elle a entraîné l’humanité et la planète entières.
En premier lieu, il faut se rappeler qu’il n’y a de capital qu’à la condition qu’il y ait du travail vivant à exploiter. Valeur en procès, le capital ne peut conserver et accroître sa valeur, ce qui est son but propre indéfiniment poursuivi dans un cycle aussi ininterrompu que possible, qu’à la condition qu’il trouve sur le marché une force de travail humaine qu’il puisse s’approprier et exploiter. Si cette force fait défaut, c’est son existence même qui est menacée.
Or la pandémie de Covid-19 confronte le capital au risque d’un pareil défaut. Ce défaut est d’ores et déjà effectif, sous la forme de la désertion d’une partie des travailleurs, faisant valoir leur droit de retrait, faute que les directions capitalistes des entreprises ne soient pas plus capables que les gouvernements de leur assurer les protections sanitaires indispensables sur leurs lieux de travail (chantiers, ateliers, entrepôts, magasins, bureaux, etc.) ; sous la forme aussi du chômage technique entraîné par la désorganisation de la production, tant vers l’amont (du côté des fournisseurs ou des sous-traitants) que vers l’aval (du côté des distributeurs) ; sous la forme enfin de la désertion des consommateurs finaux… qui se trouvent être massivement des travailleurs salariés. Et ces effets d’interruption, de ralentissement et de désorganisation de la production seront d’autant plus graves et dommageables pour le capital que la pandémie durera. Si cette dernière devait se prolonger, s’amplifier et récidiver, comme cela est fortement probable lors de la levée du confinement, la crise de valorisation du capital (correspondant en fait à une dévalorisation relative ou même absolue d’une bonne partie de ce dernier) prendrait une dimension catastrophique, amplifiant du même coup la déconfiture du capital financier dans sa composante fictive (les marchés boursiers), amorcée en fait avant la crise sanitaire et que celle-ci n’aura fait que précipiter et amplifier. Mais ce défaut de travail vivant pourrait prendre des formes encore plus catastrophiques si la pandémie devait finalement entraîner une mortalité de masse, en privant le capital de main-d’œuvre et en y rééquilibrant en faveur du travail un rapport de force sur le marché du travail que le chômage déséquilibre actuellement en faveur du capital. Et ce sans considérer, pour l’instant, les inévitables explosions sociales qui accompagneraient un pareil scénario catastrophe. D’où finalement le choix contraint du confinement, faute des moyens qui auraient permis l’option sud-est asiatique (coréenne, taïwanaise, etc.), quoi qu’il doive en coûter immédiatement au capital.
De tout cela, les directions capitalistes (gouvernementales et patronales) ont plus ou moins conscience. D’où leurs pressions répétées sur les travailleurs pour qu’ils continuent de travailler, en dépit des risques de contamination qu’elles leur font ainsi courir, en dépit de leur droit au retrait et des avis favorables donnés en ce sens par les inspections du travail ou même des tribunaux[6] ; pressions modulées cependant selon qu’il s’agit de cadres (incités à pratiquer le télétravail) ou de prolétaires (ouvriers et employés) qui sont sommés de continuer à se présenter à leur poste tous les jours, modulations dont le caractère de classe n’échappera à personne. D’où aussi leur injonction contradictoire : « Restez tous chez vous ! » mais « Continuez à aller travailler autant que possible ! » alors même que les éléments de protection les plus élémentaires (distances de sécurité, gants et masques, gels hydroalcooliques) font défaut ou sont impossibles à assurer sur les lieux de travail. D’où enfin et surtout leur impatience à sortir du confinement qui se heurte cependant à la difficulté de réunir les conditions matérielles (tests de dépistage, port de gants et de masques) et sociales (réorganisation en conséquence d’un appareil sanitaire au bord de l’effondrement) de l’opération, pour qu’elle ne risque pas de virer au fiasco en relançant la pandémie[7].
Par ailleurs, cette pandémie met en œuvre une contradiction majeure à l’œuvre dans l’actuelle phase de la « mondialisation » capitaliste, en fragilisant du coup le pouvoir capitaliste à un autre niveau encore. Contrairement à ce que la vulgate néolibérale renforcée par de nombreuses études académiques laisse entendre depuis des décennies, la « globalisation » n’a nullement rendu caduques et inutiles les États, y compris dans leur forme et dimension nationales (les États-nations). Certes, le procès immédiat de reproduction du capital, unité de son procès de production et de son procès de circulation, s’est « mondialisé » : en témoignent la « mondialisation » de la circulation des marchandises et des capitaux tout comme la « mondialisation » des « chaînes de valeur » (la segmentation des procès de production entre des lieux dispersés, en l’occurrence situés dans différents États, en faisant appel à des forces de travail inégalement qualifiées et productives et inégalement rémunérées), en donnant ainsi une dimension planétaire à « l’usine fluide, flexible, diffuse et nomade » qu’affectionnent les entreprises transnationales. Mais il n’en a pas été ainsi, ou alors à un bien moindre niveau, de la production et reproduction de l’ensemble des conditions sociales générales du procès immédiat de reproduction du capital, dont les États restent les maîtres d’ouvrage et même, en bonne partie, les maîtres d’œuvre. Par exemple, via l’appareil familial (la famille nucléaire, sa division inégalitaire du travail entre sexes et ses tutelles étatiques), l’appareil scolaire, l’appareil sanitaire, l’appareil policier et judiciaire, etc., la reproduction de la force sociale de travail (dont nous avons vu qu’elle est indispensable à la valorisation du capital) reste toujours et encore l’affaire des États-nations, tant dans leurs instances centrales que dans leurs instances décentralisées (régions, métropoles, communes, etc.). C’est ce qui justifie de parler non pas de « mondialisation » ou de « globalisation » mais plus justement de transnationalisation du capitalisme[8].
Cette division du travail reproductif du capital, qui semble fonctionnelle et qui l’est dans le cours ordinaire de la reproduction, manifeste au contraire dans les conditions actuelles la contradiction potentielle sur laquelle elle repose : celle entre un espace de reproduction immédiate du capital aux dimensions planétaires tandis que les appareils assurant la (re)production de ses conditions sociales générales restent dimensionnés et normés à l’échelle nationale. D’une part, si un virus apparu courant novembre sur quelques marchés locaux de la Chine centrale autour de Wuhan a pu donner naissance à une pandémie planétaire en à peine quelques semaines, c’est bien évidemment à l’extension et à l’intensification de la circulation des marchandises et des hommes, inhérentes à la « mondialisation » du procès de reproduction immédiat du capital, qu’on le doit et à son noyau qu’est le modèle de « l’usine diffuse et nomade », dont les réseaux couvrent la planète entière[9]; tandis que ce phénomène pathologique mondial est censé être jugulé par des États-nations agissant en ordre dispersé et chacun pour leur compte propre, érigeant en priorité la défense de l’état sanitaire de leur population respective, conduisant à transformer un monde la veille encore ouvert aux quatre vents de la « mondialisation » (pourvu qu’on ne soit pas un migrant « économique », un requérant d’asile ou un réfugié « climatique ») en une mosaïque d’États qui se ferment les uns aux autres, en ré-érigeant des barrières à leurs frontières et en réaffirmant manu militari le principe de leur souveraineté territoriale[10]. D’autre part, dans ces conditions, non seulement les appareils sanitaires nationaux sont privés de coopération entre eux, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se contentant de jouer le rôle de lanceur d’alertes répétées et d’émetteur de recommandations de bonnes pratiques, mais ils vont rapidement être mis en concurrence dès lors qu’ils vont s’adresser tous en même temps aux seules industries capables de leur fournir médicaments, équipements et appareils sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Concurrence d’autant plus aiguë et féroce que, enfin, la « mondialisation » du capital aura opéré aussi au sein de ces industries, conduisant à les délocaliser et concentrer dans certains « États émergents » (la Chine et l’Inde notamment), en privant du coup nombre d’États (y compris en Europe) de toutes ressources de cet ordre sur leur propre territoire, réalisant à ce moment-là combien ce processus, par ailleurs encouragé par les politiques néolibérales de restrictions budgétaires, les a rendus dépendants et a précarisé leur sécurité sanitaire.
En troisième lieu, la crise actuelle met en question le modèle de développement inhérent au mode capitaliste de production dans la mesure où, du fait notamment de son productivisme et de son caractère globalement incontrôlable, de son hubris en somme, il ne peut que détruire l’écosystème planétaire. Car, comme lors d’autres pathologies antérieures, plus ou moins sévères, notamment le VIH/sida (apparu en 1981), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a sévi entre novembre 2002 et juillet 2003 (déjà occasionné par un coronavirus), la grippe aviaire en 2004 due au virus H5N1, la grippe A (due au virus H1N1) en 2009, la grippe aviaire A (due au virus H7N9) apparue en 2013, le Covid-19 semble bien avoir mis en jeu une transmission entre espaces animales et espèce humaine, mettant en cause les conditions sanitaires de certains élevages (surtout en Asie mais aussi en Europe : cf. l’épisode d’encéphalopathie spongiforme bovine responsable de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) et surtout les empiétements destructeurs sur certains milieux forestiers tropicaux et autres biotopes naturels, du fait de la pression exercée sur eux par l’agriculture et notamment l’élevage, l’industrie extractive, la concentration et la diffusion urbaines, l’extension des réseaux de transports routiers, le développement du tourisme de masse, la création de parcs animaliers, etc. Ces empiétements favorisent la virulence de certains microbes (bactéries, virus, parasites) et leur transmission d’espèces animales, sur lesquelles elles peuvent être bénignes, à l’espèce humaine, sur laquelle ils sont ou deviennent pathogènes, d’autant plus que cette transmission s’accompagne souvent de leur mutation : le lentivirus du macaque est ainsi devenu le VIH[11]. Sans compter que les risques de morbidité du Covid-19 se trouvent visiblement accrus par toute une série de maux engendrés et/ou véhiculés par la « civilisation » capitaliste (sédentarité, surpoids et obésité liés à la malbouffe, pollution atmosphérique, résistance bactérienne aux antibiotiques du fait de la surconsommation de ces derniers, etc.) Dans ces conditions, la récurrence accélérée au cours des dernières décennies de ce type de pathologies, pouvant prendre un caractère pandémique, s’explique et fait craindre que la pandémie actuelle ne soit qu’un signe avant-coureur de ce qui nous attend si nous ne mettons pas fin à cette course à l’abîme dans laquelle le capitalisme nous a engagés.
*
3. A l’heure qu’il est, il est évidemment difficile et, pour partie, aventureux de tenter de prévoir ce qui va se passer une fois que la pandémie actuelle aura été jugulée – si elle peut l’être. Car tout dépendra de l’état démographique, économique, social, politique, psychique, etc., des formations sociales qu’elle aura affectées. État qui variera d’abord en fonction de la durée de celle-ci et de l’efficacité des stratégies socio-sanitaires mises en œuvre pour la juguler. Cet exercice de prospective est néanmoins nécessaire si nous ne voulons pas subir une nouvelle fois les événements.
Tout exercice de ce genre conduit à distinguer différents scénarios. En présupposant que le rapport de force entre capital et travail constituera le facteur clé de ce qui se produira alors et même d’ici là, il est possible de distinguer trois scénarios, entre lesquels des combinaisons partielles ne sont évidemment pas exclues. Ces scénarios doivent se comprendre comme des situations stylisées, en fonction desquelles il doit être possible d’interpréter les événements en cours et ceux qui sont susceptibles de se produire dans les prochains mois mais que, inversement, ces événements doivent conduire à préciser et infléchir au fur et à mesure de leur avènement. Ils ne fourniront donc des clefs d’intelligibilité qu’à cette condition d’en faire usage avec souplesse.
***
Scénario 1 : la reprise et la poursuite du business as usual néolibéral.
Il présuppose que le rapport de force entre capital et travail restera ce qu’il a été globalement ces dernières décennies, c’est-à-dire fondamentalement favorable au capital. Et c’est clairement dans cette optique que se sont placés les gouvernements actuels, en mettant déjà en place les moyens nécessaires à cette fin.
Relayant ou anticipant même la demande des entrepreneurs capitalistes, leur priorité est la relance de « l’économie », entendons le procès de production et de circulation du capital, permettant le redémarrage de la valorisation et l’accumulation de ce dernier à grande échelle. Cela suppose de contraindre les travailleurs à reprendre au plus vite et le plus massivement possible le chemin vers leurs lieux d’exploitation ; et les pressions en ce sens, qui n’ont pas cessé depuis le début de la pandémie, augmenteront au fur et à mesure où celle-ci régressera. Elles opéreront par le biais de la cessation de l’indemnisation du chômage technique, mise en place pour permettre précisément à « l’économie » de redémarrer au plus vite après le « trou d’air » qu’elle connaît actuellement, et de la menace du licenciement pour les récalcitrants.
Pour autant, cette relance ne pourra pas être un pur et simple retour au statu quo ante. D’une part, en dépit des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises (via le report ou même l’annulation partielle des impôts et cotisations sociales et la prise en charge du chômage partiel) et de l’ouverture de larges possibilités d’emprunts, garantis pour certains par l’État[12], il faut prévoir la faillite de nombreuses entreprises, et pas seulement parmi les PME qui sont les plus exposées, et une passe difficile pour de nombreuses autres, du fait de la désorganisation des relations interentreprises (en amont et en aval de chacune) que ces faillites vont entraîner. Cela va se traduire par une concentration et centralisation accrues du capital dans tous les secteurs et branches, dont l’emprise sur « l’économie » va donc s’accroître, mais aussi par une hausse de leur taux de profit, du fait de la disparition d’une partie du capital en fonction, actuellement en état de suraccumulation. Cependant que les perspectives d’investissement vont être obérées par la dévalorisation de leur capital que les investisseurs institutionnels viennent d’enregistrer en bourse, qui va les rendre à la fois plus frileux et plus exigeants en termes de garantie de retour sur investissement. Avec pour résultante globale une augmentation du chômage, que ne palliera pas entièrement le redémarrage de la consommation (productive et improductive) qui suivra la fin du confinement, et qui viendra déséquilibrer un peu plus encore le rapport de force sur le marché du travail en faveur du capital.
D’autre part, celles des entreprises qui parviendront à s’en sortir, et pour s’en sortir précisément, chercheront à accroître l’exploitation du travail, en jouant principalement sur sa durée et son intensité, la hausse des gains de productivité ralentissant régulièrement depuis quelques décennies[13]. A cette fin, elles pourront évidemment profiter de la hausse du chômage pour activer un peu plus encore le chantage au licenciement ; mais elles pourront aussi bénéficier de l’appui des gouvernements sous la forme d’un durcissement des conditions légales d’emploi, de travail et de rémunération. En France par exemple, elles pourront s’appuyer sur l’ensemble des mesures dérogatoires à ce qu’il reste du Code de travail qui ont été adoptées dans le cadre de la loi instituant « l’état d’urgence sanitaire » qu’il suffira de proroger en « état d’urgence économique ». Rappelons que ces dérogations concernent
« la facilitation du recours à l’activité partielle ; la possibilité d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance, ou d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié ; l’autorisation donnée aux entreprises particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ; à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités des versements au titre de l’intéressement ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourront être modifiées »[14].
Et signalons qu’à ce jour (15 avril) le décret devant préciser les secteurs dans lesquels ces dérogations ne devaient pas s’appliquer n’est toujours pas paru.
Enfin, la crise économique qui aura accompagné la crise sanitaire n’aura pas mis à mal seulement la trésorerie des entreprises : elle aura également brutalement dégradé l’état des finances publiques, du fait tant du gonflement des dépenses occasionnées par les plans de soutien à « l’économie »[15] que de la contraction des recettes fiscales liées à la panne d’une partie de cette même « économie » (notamment du côté de l’impôt sur le capital et des impôts indirects taxant la consommation)[16], en provoquant un surcroît de déficit public[17], couvert comme d’habitude par recours à l’emprunt. D’où d’ores et déjà une brusque hausse des taux d’intérêt sur les emprunts publics auparavant orientés à la baisse, même nuls dans certains cas, que les principales banques centrales ont tenté de prévenir et limiter par une nouvelle vague de quantitative easing[18]. D’où aussi la relance de projets d’eurobonds (surnommés en l’occurrence covibonds) : d’émissions de titres de crédit par l’ensemble des États de l’Union, par le biais de la BCE, revenant donc à mutualiser ce surcroît de dettes publiques pour venir en aide aux États membres les plus affectés par la pandémie dont les conditions d’emprunts sur les marchés financiers sont aussi les moins favorables (Italie, Espagne, Portugal) ; ce qu’ont refusé, pour l’instant, comme à l’ordinaire l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande, faisant prévaloir leur souveraineté nationale sur une opération qui aurait représenté un pas en avant sur la voie de la constitution d’un État fédéral européen[19].
Dans la perspective de ce premier scénario, cette dégradation des finances publiques aurait pour conséquence à peu près certaine le redoublement de la politique austéritaire précédemment pratiquée par les gouvernements, impliquant aussi bien une hausse des impôts et des cotisations sociales portant sur le travail et la consommation finale qu’une baisse des dépenses publiques, partant des coupes claires dans les budgets affectés à la couverture des besoins sociaux les plus élémentaires : logement, transport, éducation et même santé. Car la crise que nous subissons actuellement du fait de décennies de sous-investissement public sanitaire pourrait ne pas infléchir les orientations antérieures en la matière, si l’on en juge par exemple par l’étude que vient de remettre la Caisse des dépôts et consignations, laquelle envisage de s’en remettre à des partenariats public-privé pour pallier le défaut d’investissements publics dans les hôpitaux[20]. Ou si l’on s’en remet aux déclarations du directeur de l’Agence régional de santé de la Région Grand Est, selon lesquelles une fois la pandémie passée il y aura lieu de poursuivre le plan d’économies prévu pour l’hôpital de Nancy en y supprimant 598 emplois et 174 lits[21] ! Même orientation aberrante en Suisse où, en pleine crise du Covid-19, le Conseil fédéral planifie une diminution des recettes des hôpitaux de cinq à six cents millions de francs au minimum[22].
Et, pour boucler le tout, afin de prévenir tout mouvement social qui s’opposerait à un pareil rétablissement de l’état et de la dynamique catastrophique antérieurs, impliquant de passer la crise sanitaire et ses conséquences sociales par pertes et profits et de blanchir les gouvernants en place de toute responsabilité en la matière, ces derniers pourraient toujours compter sur le maintien voire le durcissement du régime de restriction des libertés publiques mis en place pour faire face à la pandémie, dont le Syndicat de la magistrature s’est lui-même ému en France[23]. Et ils sauraient à coup sûr tirer parti du nouveau seuil de surveillance généralisée que le confinement aura permis de franchir, à coups de surveillance des espaces publics par drones et capteurs de chaleur et des déplacements individuels par tracking des téléphones portables. « Big Brother » deviendrait un compagnon aussi intrusif qu’inévitable dès lors que l’on sortirait de chez soi. S’ils devaient y parvenir, il parachèverait du même coup des évolutions amorcées à l’occasion de la lutte contre cet autre ennemi invisible, l’ainsi dénommé « terrorisme », qui aura inauguré une restriction chronique des libertés publiques et la marche vers un pouvoir panoptique de surveillance, de contrôle et de répression.
Enfin, ils pourraient également compter sur les effets persistants de l’état psychique créé par cette pandémie et les mesures de confinement qui ont été imposées pour y faire face : l’autodiscipline dans l’acceptation de l’état d’exception comme forme normale du gouvernement ; l’attitude de méfiance envers les autres comme envers soi-même comme sources possibles de menace (facteur d’infection), s’exprimant à travers leur mise à distance, les « gestes barrières », le port de gants et de masques ; plus profondément, enfin, une perte de confiance dans le monde. Pour ne rien dire du traumatisme subi par ceux et celles qui auront perdu l’un-e des leurs, sans avoir même pu se recueillir auprès de leur dépouille, rite pourtant nécessaire à tout travail de deuil. Autant d’éléments peu propices au développement de mobilisations collectives.
En somme, ce premier scénario répéterait la séquence que l’on a vu jouer à l’issue de la crise financière de 2007-2009, dite crise des subprime, en pire. Alors, la remise en cause des dogmes néolibéraux par la crise aura été l’occasion pour les gouvernants de réaffirmer autoritairement ces dogmes, en tirant argument de ce que la crise n’aurait pas résulté de leur application mais, au contraire, des insuffisances de cette même application, qu’il convenait par conséquent de poursuivre et redoubler[24]. Fidèles à la « stratégie du choc » (Naomi Klein) qui leur a toujours réussi jusqu’à présent, il ne fait guère de doute que « nos » gouvernants vont tenter de profiter du choc économique, financier, social, psychologique de la crise (sanitaire) actuelle pour prolonger et redoubler la mise en œuvre de ces politiques, en cherchant ainsi à masquer et faire oublier la lourde responsabilité de ces dernières et d’eux-mêmes qui les ont administrées dans le déclenchement et la gestion calamiteuse de cette crise.
Les faiblesses d’un pareil scénario sont cependant multiples. Outre qu’il n’est pas assuré que les gouvernants parviennent à maîtriser si facilement les mouvements sociaux que sa mise en œuvre ne manquerait pas de produire, sauf à faire prendre une allure dictatoriale à leur mode de gouvernement (comme c’est déjà le cas en Hongrie), il fait surtout l’impasse sur les deux derniers des défis lancés par l’actuelle pandémie au pouvoir capitaliste précédemment mentionnés. Il ne remédierait en rien à la contradiction inhérente à la transnationalisation du capital que j’ai pointée, qui fait reposer en définitive sur les épaules des seuls États-nations la (re)production des conditions générales de ce rapport social, alors même qu’il se déploie quotidiennement au-delà de leurs frontières et de leur espace de souveraineté. Quant au fait que la pandémie actuelle se présente vraisemblablement comme un simple développement particulier, mais particulièrement aigu, de la catastrophe écologique planétaire dans laquelle le mode capitaliste de production a engagé l’humanité tout entière, la poursuite des politiques néolibérales en aurait d’autant moins cure qu’elles sont par définition totalement aveugles aux « externalités négatives » du procès capitaliste de production[25]. Autrement dit, la réalisation d’un pareil scénario ouvrirait grandes les portes à la réédition à court ou moyen terme de pareilles crises, y compris à plus vastes échelles encore.
***
Scénario 2 : un tournant néo-social-démocrate
La gestion calamiteuse de la crise sanitaire par les gouvernants, qui risque de se prolonger voire de s’aggraver au moment de la levée des confinements, les mesures austéritaires qu’ils pourraient être amenés à prendre pour relancer « l’économie », les tentatives de reprise et de prolongement du programme de « réformes » néolibérales qui leur a servi d’agenda avant la présente crise, tout cela peut aussi bien provoquer, par réaction, des mouvements sociaux leur demandant des comptes quant à leur responsabilité dans cette affaire et leur imposant des inflexions par rapport aux orientations antérieures. Ces mouvements trouveraient facilement à s’alimenter au discrédit de ces mêmes gouvernants, né du spectacle de leur impéritie, de la colère et des frustrations engendrées par le confinement, de la volonté de trouver des responsables et des coupables à ce fiasco de grande ampleur, discrédit qui pourrait rejaillir sur l’ensemble des politiques néolibérales antérieures dont le caractère néfaste et proprement criminel même a été démontré à grande échelle par la crise sanitaire engendrée par le délabrement du service public de santé, dont ces politiques sont directement responsables.
Il ne fait pas de doute que les personnels de santé seraient en première ligne de pareils mouvements, tout particulièrement ceux des hôpitaux publics, qui tout au long de l’année dernière n’ont cessé de dénoncer la casse de l’appareil sanitaire en obtenant pour seules réponses au mieux le mépris des irresponsables qui leur tiennent lieu de supérieurs, quand ce n’est pas les gaz lacrymogènes et la matraque, et qui, au péril de leur vie, auront été en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Ils seraient, espérons-le, appuyés par tous ceux et celles qui auront été sauvés par leurs soins, accompagnés de leurs proches ; mais aussi de tous ceux et celles dont l’un-e des leurs est mort-e dans des conditions indignes, alors qu’une autre politique de santé publique aurait pu les sauver ; et, plus largement, de tous ceux et celles qui auraient pris conscience à cette occasion de la nécessité de se mobiliser pour faire cesser pareille casse. Et ils et elles seraient certainement relayés par tous les chercheurs qui auront vu leurs recherches sur les virus littéralement sabordées sous l’effet des restrictions budgétaires[26].
On peut également espérer que le confinement aura rendu insupportable à un grand nombre l’insuffisance, quantitative et qualitative, du logement social et, plus largement, leurs conditions de logement, notamment en milieu urbain, tout en leur faisant prendre conscience de la nécessité d’engager un plan massif de construction et de rénovation. Sans même vouloir évoquer les conditions misérables et indignes dans lesquelles auront été confinées, en France mais sans doute aussi ailleurs, les personnes incarcérées[27], celles maintenues dans les centres de rétention administrative[28] ainsi que celles internées pour raison psychiatrique[29], que le confinement aura particulièrement éprouvées, elles aussi bien que leurs proches et soutiens.
Il est évidemment difficile de prévoir sur quelles perspectives politiques globales pourraient déboucher de pareils mouvements sociaux, s’ils devaient se produire. Quoi qu’il en soit, ils conduiraient à une inflexion du rapport de force entre capital et travail. L’ampleur et la durée de cette inflexion dépendraient évidemment du degré de leur radicalité et, partant, de leur orientation dominante.
Cela conduit à envisager un deuxième scénario qui déboucherait sur un nouveau compromis entre capital et travail du même ordre que celui qui avait soldé, dans les années 1930 et 1940, la crise structurelle que le capitalisme avait traversée à l’époque et les luttes sociales et politiques, nationales et internationales, qui l’avaient accompagnée – compromis ordinairement qualifié de fordiste ou de social-démocrate. Destinée à remettre le capitalisme en selle tout en en infléchissant notoirement le fonctionnement, la réalisation d’un tel scénario supposerait que les différents défis lancés par la crise actuelle, précédemment détaillés, soient relevés d’une manière ou d’une autre. Dans cette mesure même, elle supposerait de combiner des inflexions majeures selon trois axes différents.
En premier lieu, une rupture nette avec les politiques néolibérales. Parmi les points de rupture majeurs, il conviendrait, d’une part, de procéder à un partage de la valeur ajoutée plus favorable au travail par des créations d’emplois et par une hausse généralisée et substantielle des salaires réels, davantage d’ailleurs du salaire indirect que du salaire direct. D’autre part, en rapport avec le point précédent, il faudrait procéder une augmentation de la dépense publique en faveur de la protection sociale, des services publics (en priorité l’éducation et la santé) et des équipements collectifs (notamment du logement social). Enfin, et en conséquence des deux points précédents, s’imposerait une inflexion sérieuse des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales), impliquant notamment une baisse de la fiscalité directe (CSG : contribution sociale généralisée) et indirecte (TVA et autres taxes sur la consommation) pesant sur les salaires et une hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises (impôt sur les sociétés), sur les hauts revenus (via la réintroduction de tranches supérieures d’imposition sur le revenu) et les gros patrimoines, visant tant leur possession (par réintroduction et augmentation de l’impôt sur la fortune) que leur transmission[30].
L’inflexion du rapport de force entre capital et travail passerait, en deuxième lieu, par une « démondialisation » partielle du procès immédiat de reproduction du capital. Cela supposerait, pour commencer, de définir un champ de souveraineté économique national[31], autrement dit un ensemble de secteurs ou de branches dont le contrôle par l’État est considéré comme stratégique du point de vue de la sécurité de sa population ; un tel champ devrait inclure, a minima, outre l’agroalimentaire, le logement social, le sanitaire[32], l’éducatif et la recherche scientifique. Cela pourrait impliquer, par conséquent, la (re)nationalisation des entreprises placées en position de monopole ou d’oligopole dans chacun des secteurs ou branches précédents (au premier chef desquelles les industries pharmaceutiques) ; plus largement, la subordination étroite de l’ensemble des entreprises opérant dans ces secteurs et branches à des règles, propres à assurer une telle souveraineté, en ce qui concerne leurs décisions d’investissement ou de désinvestissement, de recherche et de développement, d’allocation de leurs profits. Et, pour compléter le tableau, il ne faudrait pas oublier de taxer l’ensemble des entreprises transnationales de telle manière à limiter drastiquement leurs opérations d’optimisation et de fraude fiscale, en les imposant en due proportion des opérations qu’elles réalisent sur le sol national.
En troisième lieu, en s’inspirant des projets de Green New Deal[33], il s’agirait de mettre en œuvre un plan massif d’investissements publics en faveur de la lutte contre la catastrophe écologique, en ciblant en premier lieu le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité, impliquant notamment : des aides au développement des énergies renouvelables, l’isolement thermique des bâtiments, privés et publics, le développement des transports publics, notamment dans les espaces ruraux et périurbains, la reconversion de l’agriculture vers le bio et les circuits courts, etc.
Se pose alors une première question : celle des conditions de possibilité subjectives d’un pareil scénario, autrement dit celle de savoir quelles forces sociales et politiques seraient susceptibles de prendre en charge un pareil projet et programme réformiste et, le cas échéant, comment elles seraient en mesure de faire bloc à cette fin. Pour l’instant, aucun mouvement social ni aucune formation politique constituée, à capacité gouvernementale, ne défendent un tel programme. On ne trouve rien de tel du côté de ce qu’il reste des partis soi-disant socialistes, social-démocrates ou travaillistes, qui pourraient pourtant utilement se renouveler à cette occasion, englués et dilués qu’ils restent dans leur ralliement antérieur, honteux ou tapageur, au néolibéralisme[34]. Pas davantage ne trouve-t-on quelque chose de cet ordre du côté des formations écologistes. Europe Écologie Les Verts en restent pour l’instant à dénoncer les causes immédiates de la crise sanitaire[35] et réduisent le Green New Deal à « une fiscalité plus redistributive : à situation exceptionnelle impôt exceptionnel, en particulier pour les grandes fortunes et les assurances qui engrangent des profits indus pendant le confinement »[36].
Même les propositions soumises par la Convention citoyenne pour le climat s’avèrent minimales[37]. Après avoir noté très justement que « la perte de biodiversité, la destruction des milieux naturels, sont des témoins de la crise écologique, mais sont aussi pointés comme des facteurs importants de la crise sanitaire d’aujourd’hui » et que « la multiplication des échanges internationaux et nos modes de vie globalisés sont à l’origine de la propagation rapide de l’épidémie », elle se contente de souhaiter que « la sortie de crise qui s’organise sous l’impulsion des pouvoirs publics ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l’humain et de la biodiversité », elle se contente en tant que préconisations de suggérer que « des grands travaux soient lancés pour réduire la dépendance de la France aux importations, favoriser l’emploi en France et réduire les émissions de gaz à effet de serre » et de rappeler « qu’il est nécessaire de relocaliser les activités des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique » ainsi que « l’importance des solidarités internationales pour une action efficace ». Bref de bonnes intentions sans plan plus précis pour les exécuter.
Tout juste perçoit-on pour l’instant quelques voix reprenant les propositions précédentes. Des voix dispersées qui sont loin encore de constituer un chœur. Il faudrait donc compter sur la mobilisation collective précédemment envisagée pour leur permettre de s’amplifier et de s’unifier.
D’ores et déjà, certaines organisations syndicales se sont placées dans une telle perspective réformiste. La CGT, par exemple, a adressé au président de la République une lettre ouverte dans laquelle elle lui demande d’infléchir l’ensemble de sa politique antérieure en lui soumettant les propositions suivantes :
« Relocalisation des activités, dans l’industrie, dans l’agriculture et les services, permettant d’instaurer une meilleure autonomie face aux marchés internationaux et de reprendre le contrôle sur les modes de production et d’enclencher une transition écologique et sociale des activités.
Réorientation des systèmes productifs, agricoles, industriels et de services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et axés sur le rétablissement des grands équilibres écologiques.
Établissement de soutiens financiers massifs vers les services publics, dont la crise du coronavirus révèle de façon cruelle leur état désastreux : santé publique, éducation et recherche publique, services aux personnes dépendantes…
Une remise à plat des règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre l’évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront être mis davantage à contribution, via une fiscalité du patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive »[38].
Et il n’est pas même exclu que, du côté des gouvernants, de pareilles propositions soient entendues et reprises pour partie. C’est Emmanuel Macron qui, après s’être lamenté du « pognon de dingue » que coûteraient les minima sociaux et avoir affirmé haut et fort sa volonté d’y mettre bon ordre par la responsabilisation des assurés sociaux[39], découvre brusquement que
« la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe »[40].
Et, même brusque révélation du caractère néfaste des politiques néolibérales outre-Rhin chez sa collègue Angela Merkel :
« “Bien que ce marché [celui des masques de protection] soit actuellement situé en Asie, il est important que nous tirions de cette pandémie l’expérience que nous avons également besoin d’une certaine souveraineté, ou au moins d’un pilier pour effectuer notre propre production ”, en Allemagne ou en Europe, a-t-elle défendu »[41].
Certes, on sait d’expérience ce que valent ces déclarations faites dans le feu du désarroi par des dirigeants qui se sont rendus coupables de ce à quoi ils promettent de remédier, avant de revenir à leurs anciennes amours et pratiques à peine la crise passée. Mais il n’en est pas moins significatif que les « premiers de cordée » du néolibéralisme pur et dur au niveau européen se soient laissé aller à de pareils propos.
Mais cette perspective réformiste soulève encore une seconde question : celle de ses conditions de possibilité objectives, soit celle des obstacles et limites auxquelles sa réalisation se heurterait dans l’état actuel du mode capitaliste de production. Deux de ces limites sautent immédiatement aux yeux. D’une part, le rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée en faveur du salaire et au détriment du profit, assorti d’une augmentation des prélèvements obligatoires pour financer tant la remise à niveau des équipements collectifs et des services publics que le plan massif d’investissements publics en faveur de Green New Deal, des mesures qui se recoupent et se chevauchent pour partie certes, ne se heurteraient pas moins à la baisse tendancielle des gains de productivité précédemment signalée. Autrement dit, les gains de productivité ne seraient sans doute plus suffisants pour financer à la fois la valorisation du capital (via les profits), la hausse des salaires réels et la hausse des dépenses publiques en faveur d’un vaste programme d’investissement à but social et écologique. En somme, il existe une sorte de triangle d’incompatibilité entre ces trois objectifs.
D’autre part, si un Green New Deal est en mesure d’atténuer les effets écologiquement désastreux de la poursuite d’une accumulation du capital débridée, de freiner par conséquent la dynamique de la catastrophe écologique globale engendrée par cette dernière, il est parfaitement incapable de résoudre la contradiction entre la nécessaire reproduction élargie du capital (son accumulation), qui ne connaît pas de limite, et les limites de l’écosystème planétaire. Pour le dire autrement et plus simplement, il peut y avoir des capitaux verts mais pas de capitalisme vert[42]. Sous ce rapport aussi, le capitalisme a sans doute atteint ses limites et le réformisme avec lui. Et, s’il devait se produire, le tournant néo-social-démocrate aurait de ce fait toute chance de nous engager dans une impasse à moyen terme.
***
Scénario 3: ouvrir des brèches en vue d’une rupture révolutionnaire
On est dès lors en droit d’imaginer un troisième scénario, bien qu’il semble a priori plus improbable encore que le précédent. Il part de l’hypothèse selon laquelle plus une crise du mode de production capitaliste est profonde, plus elle manifeste ses contradictions insurmontables et ses limites indépassables, plus elle crée les conditions à l’ouverture de brèches par lesquelles peuvent s’engouffrer les forces sociales et politiques œuvrant à une rupture révolutionnaire, qui trouvent leur base naturelle dans le salariat d’exécution (ouvriers et employés, tous secteurs et branches confondus) qui définit aujourd’hui le prolétariat.
Or c’est bien un pareil processus qui est d’ores et déjà actuellement engagé, au cœur de cette crise, fût-ce de manière encore embryonnaire mais significative. Donnons-en quelques exemples. Contre les pressions redoublées des gouvernants et des employeurs et leur double langage, ce sont les travailleurs et travailleuses qui, par leur retrait spontané, leurs débrayages ou même par des grèves, ont imposé l’arrêt de la production ou sa poursuite à la seule condition du respect de normes de sécurité (distance, port de gants et de masques, désinfection des locaux, etc.), dans le simple but de préserver leur santé et leur vie[43]. Ce qu’ils et elles ont ainsi clairement affirmé, c’est qu’ils-elles sont les seuls maîtres en dernière instance du procès de production : que ce sont eux-elles qui produisent toute la richesse sociale et qui sont aussi en capacité de faire cesser cette production. Vérité foncière que toute l’idéologie dominante dans ses différentes facettes occulte sans cesse en temps ordinaire.
S’est aussi imposée dès lors, dans la pratique même mais aussi dans la conscience réflexive qui l’a accompagnée, la nécessité de distinguer entre les activités productives strictement nécessaires à la poursuite de la vie sociale (santé, alimentation, services de base : eau, gaz, électricité, etc.), et qu’il a fallu poursuivre sous certaines conditions de sécurité, et celles qui sont superflues voire nuisibles, dont on peut se passer ou qu’il est même souhaitable de mettre à l’arrêt (la production automobile, l’industrie militaire, les chantiers navals – liste non exhaustive). Même si elle n’est pas facile à opérer, tant les activités productives sont imbriquées les unes dans les autres dans tout appareil de production socialisé[44], et précisément parce qu’elle n’est pas facile à opérer, cette distinction soulève la question de ce que, dans un processus de transition socialiste, il conviendrait de maintenir de l’appareil de production existant, au moins dans un premier temps et en le transformant, et de ce qu’il conviendrait d’abandonner immédiatement ou de reconvertir profondément, dans le cadre d’une planification de la production en fonction de la nécessité et de l’urgence de satisfaire les besoins sociaux les plus fondamentaux. De telles reconversions ont d’ailleurs d’ores et déjà commencé : on a vu des entreprises textiles se lancer dans la confection de masques chirurgicaux, des parfumeries dans la production de gel hydroalcoolique, des entreprises automobiles dans la mise au point d’appareils d’assistance respiratoire, etc.[45]
Sous la pression de la nécessité mais aussi sous l’effet de la solidarité entre « ceux-celles d’en bas » conscients de l’incurie et de l’indifférence de « ceux-celles d’en haut », on a vu se mettre en place et se développer, un peu partout, au niveau local, des pratiques et des réseaux d’entraide pour faire face aux difficultés et problèmes résultants du développement de la pandémie et des mesures de confinement, notamment en faveur des plus démunis d’entre ces expropriés que sont par définition les prolétaires : travailleurs précaires et chômeurs, femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales, personnes âgées isolées, mal logés et SDF, étrangers sans papier, réfugiés, etc. Selon le cas et les lieux, il s’est agi de la préparation de paniers repas ; de collectes de nourriture, de produits de protection et d’hygiène ou de vêtements, de livres, de DVD, etc. ; de soins à domicile ; de lutte contre la solitude et l’isolement ; de mises en place de structures d’aide scolaire à destination des enfants confinés et privés de scolarité ; de réquisitions de chambres d’hôtel ; d’interventions en préfecture pour y obtenir des régularisations, etc. Ces actions ont eu d’autant plus de consistance qu’elles ont pu s’appuyer sur des collectifs ou des réseaux préexistants, tels les Amap[46] dont l’utilité s’est illustrée en ces temps où le ravitaillement en grandes surfaces est devenu problématique. L’importance de ces pratiques et réseaux ne se mesure pas seulement à leurs effets immédiats en termes de solidarité concrète mais encore en ce qu’ils sont autant d’occasions de mettre en évidence et en accusation les défauts actuels des appareils de protection sociale et plus largement des pouvoirs publics, conséquences de leur étranglement financier par les politiques néolibérales mais aussi de leur structure bureaucratique traditionnelle. Surtout, en tant qu’éléments d’auto-organisation populaire, ils constituent autant de préfigurations de cette autogestion généralisée que serait une société libérée de toute structure d’exploitation et de domination ; et c’est à ce titre qu’ils méritent de figurer ici[47].
Enfin, en cette période où « l’économie » est en bonne partie en panne, où les marchandises et l’argent circulent avec peine, où la survie dépend moins des échanges marchands que de la solidarité interpersonnelle ou associative et de la distribution de la manne étatique, on a vu (ré)apparaître partout la gratuité. Aiguillonnés par la peur de perdre le contact avec leurs clients cloués chez eux, les éditeurs se sont mis à proposer gratuitement une (toute petite) partie de leur fonds ; différents producteurs de cinéma et différentes plates-formes de vidéos à la demande en ont fait autant ; etc. Pour intéressée et temporaire que soit cette gratuité, elle n’en indique pas moins ce que devrait être l’accès à la culture dans une société libérée de l’emprise de la propriété privée et du marché : un service public et gratuit à la portée immédiate de tout un chacun.
Au titre des autres bénéfices paradoxaux de la panne actuelle de l’économie capitaliste, il faut signaler la chute spectaculaire des différentes formes de pollution que celle-ci engendre dans son cours ordinaire. Baisse de la pollution atmosphérique un peu partout dans le monde : en Chine[48], en Europe[49], en Inde[50]. Baisse sensible de la pollution sonore liée à la circulation automobile, qui permet d’étendre à nouveau le souffle du vent dans les frondaisons et les chants d’oiseau. Baisse de la pollution publicitaire sur les ondes. Quasi-disparition de la pollution de la communication téléphonique du fait de la fermeture des centres d’appels. Autant de manifestations in vivo que l’on vit mieux sans le capitalisme, dont seules les mesures de confinement qu’il continue à nous imposer nous empêchent de profiter pleinement.
Bref, de multiples manières, la crise actuelle ouvre des brèches dans le système des rapports, des pratiques et des représentations par lesquels s’exerce ordinairement la domination du capital, avec son inévitable lot de nuisances, qui laissent clairement apercevoir qu’un autre monde est possible et qu’il est même nécessaire et souhaitable, dès lors que cette domination fait faillite, comme c’est en bonne partie le cas actuellement. Ce sont précisément ces brèches que, dans la perspective de ce troisième scénario, il va falloir chercher à élargir à la faveur des luttes en cours et qui vont s’exacerber dès lors que les directions capitalistes, gouvernementales et patronales, chercheront à revenir au statu quo ante.
Ces luttes vont avoir pour premier enjeu les conditions dans lesquelles va s’opérer la reprise de la production. Alors que le coronavirus responsable de la pandémie n’aura pas été totalement éradiqué et en l’absence de tout vaccin, les travailleurs et travailleuses vont devoir se battre pour imposer que cette reprise se fasse aux conditions qu’ils sont parvenus à imposer jusqu’à présent : distinction entre les activités socialement nécessaires et le reste ; sécurisation des espaces de travail (chantiers, ateliers, bureaux) avec strict respect des normes de sécurité (distance, port de gants et de masques, désinfection des locaux, etc.) ; mesures qu’il faudra étendre plus largement à l’ensemble de la population, qu’elle soit active ou non. Ils vont de même devoir se battre contre les tentatives d’aggraver leur exploitation en augmentant la durée et l’intensité de leur travail pour permettre au capital d’effacer une partie des pertes (des manques à gagner, de la baisse des profits et des taux de profit) qu’il aura enregistré durant la crise, moyennant la suspension ou même la suppression des dispositifs du Code du travail à ce sujet : dans une situation où le chômage aura augmenté du fait de la faillite d’un grand nombre d’entreprises, le mot d’ordre « travailler tou-te-s pour travailler moins tout en travaillant autrement » sera plus que jamais à l’ordre du jour. Autrement dit, s’il faut se retrousser les manches pour regagner le terrain perdu, que cela se fasse sous forme d’embauches massives, permettant une diminution du temps de travail pour chacun-e, et non pas sous celle d’un surcroît d’exploitation des seuls salarié-e-s en emploi. Dans le même ordre d’idées, il va leur falloir imposer que les revenus des actionnaires (dividendes) et ceux des managers (leurs sursalaires) soient rognés ou même abolis pour faire face aux difficultés des entreprises et mis à profit pour relancer les investissements. Enfin, pour pallier la vague de faillites et de licenciements collectifs qui résultera presque à coup sûr de l’arrêt prolongé de la production, les travailleur-euse-s devront se mobiliser pour imposer la socialisation, sous leur contrôle, des entreprises dont la production sera considérée comme socialement nécessaire, rendant du même coup la distinction précédente d’autant plus opératoire.
En second lieu, il n’est pas question d’oublier les enseignements de la présente crise. Au contraire, il s’agira d’en tirer les conséquences et quant à la réorganisation nécessaire de l’appareil de production et quant aux orientations des dépenses publiques. La priorité est de reconstituer un appareil sanitaire impliquant notamment : l’annulation de la dette des hôpitaux publics ; l’arrêt des subventions aux cliniques privées et l’interdiction des dépassements d’honoraires en médecine de ville ; un plan pluriannuel d’embauche de personnels soignants, de réouverture de services et d’établissements, de dotations budgétaires pour la recherche, libérée de toute tutelle et dépendance capitaliste ; une nationalisation des grands groupes pharmaceutiques comme plus largement de toutes les entreprises produisant du matériel médical ; le tout sous le contrôle des travailleurs du secteur et de leurs organisations syndicales, en association avec la population qui est directement concernée par le sujet, en sa double qualité de contribuable et de bénéficiaire potentiel de ce service public[51]. Objectifs qu’il faudra imposer par des mobilisations collectives prolongées : grèves, manifestations, occupations, interpellations de responsables politiques, boycotts, etc.
Mais c’est plus largement en faveur d’un investissement massif dans l’ensemble des équipements collectifs et services publics assurant la satisfaction des besoins sociaux les plus fondamentaux : en plus de la santé, le logement, l’éducation, la recherche scientifique, là encore en les plaçant sous le contrôle des salariés de ces secteurs et de leurs organisations syndicales.
En troisième lieu, il faut profiter de ce que la suspension durable de « l’économie » a mis en évidence que la société ne nécessitait, pour satisfaire ses besoins essentiels, qu’un nombre restreint d’entreprises, d’équipements collectifs et de services publics, mais aussi un pilotage de l’ensemble par l’État, en contradiction complète des dogmes néolibéraux, pour exiger la reconversion en conséquence de l’ensemble de l’appareil productif, mais cette fois-ci sous contrôle des travailleurs et de leurs organisations syndicales. Et, pour piloter cette reconversion, l’expropriation des banques privées, des compagnies d’assurances et des fonds d’investissement, sans indemnisation de leurs actionnaires, et leur fusion en un organisme public d’investissement, sous contrôle de ses salariés et, plus largement, de l’ensemble des citoyens conviés à un débat sur les orientations prioritaires à donner aux investissements en question[52].
En dernier lieu enfin, il va falloir se battre pour imposer une annulation pure et simple de l’ensemble des dettes publiques, doublée d’une réforme des prélèvements obligatoires de manière à taxer le capital, les hauts revenus et les grandes fortunes. Car les dettes publiques procèdent purement et simplement de l’accumulation des arriérés d’impôts et de cotisations non exigés de la part d’entreprises et de ménages qui auraient pourtant eu les capacités contributives et partant l’obligation de les acquitter, puisqu’ils ont trouvé les moyens de se faire les créanciers des États avec l’argent que ceux-ci ne leur ont pas demandé[53].
Il n’échappera à personne qu’un certain nombre d’axes de lutte selon lesquels devrait se développer ce scénario de rupture recoupent certains des objectifs du scénario précédent, d’orientation réformiste. C’est que, radicalisés, les objectifs de ce dernier peuvent conduire à ouvrir des brèches dans le système existant et ne pas seulement contribuer à sa reconduction sous de nouvelles formes. C’est bien pourquoi j’indiquais plus haut que l’issue des mobilisations collectives qui vont se dessiner dans les prochains mois est incertaine et dépendra essentiellement de leur degré de radicalité.
D’emblée cependant, deux éléments distinguent ce scénario de rupture du précédent. C’est, d’une part, l’importance primordiale qu’il demande d’accorder aux initiatives prises par la base (« les gens », les travailleurs, leurs organisations) dans le but de promouvoir de nouvelles pratiques et structures d’émancipation. C’est, d’autre part, l’objectif qu’il vise d’imposer des mesures de « contrôle populaire » sur la production (sa finalité et ses modalités : que doit-on continuer à produire ? que faut-il maintenir ? que faut-il abandonner ? que faut-il réquisitionner ? à quelles conditions ?) pour imposer sa réorganisation dans le cadre d’une planification démocratique orientée en fonction de la définition des besoins sociaux.
***
En conclusion, il s’agit de ne pas laisser se perdre ce que cette crise nous aura appris : la nécessité et l’urgence de sortir du capitalisme… et la possibilité d’y parvenir. Nécessité et urgence qui s’alimentent tout simplement au constat que, au stade actuel de son développement, le capitalisme est voué de plus en plus à n’engendrer que la mort : la mort biologique qu’enregistre la sinistre comptabilité de la croissance quotidienne des victimes de la pandémie actuelle, en attendant que, demain, l’aggravation de la catastrophe écologique ne nous confronte à bien pire encore ; mais aussi la mort sociale à laquelle sont condamnés les rescapé-e-s par le confinement et la suspension (pour combien de temps encore ?) des libertés individuelles et collectives, à laquelle ils se soumettent en espérant que la Grande Faucheuse ne les rattrapera pas, contraint-e-s en attendant pour certain-e-s de vivre comme des rats ; quand ce n’est pas la mort psychique pour ceux et celles qui ne trouvent pas en eux et elles les ressources permettant de faire face à ce type d’épreuve et qui sombrent dans la dépression ou recourent au suicide.
Depuis un siècle, combien de fois n’a-t-on pas répété la formule d’Engels reprise par Rosa Luxembourg : socialisme ou barbarie ? Il est temps de prendre conscience que l’alternative est aujourd’hui beaucoup plus radicale : elle est tout simplement entre le communisme et la mort.
Alain Bihr, 15 avril 2020.
Notes
[1] Merci à Roland Pfefferkorn et Yannis Thanassekos de m’avoir permis, par leurs suggestions et remarques, d’améliorer la version primitive du texte que je leur avais soumise.
[2] Le pompon en la matière revient incontestablement aux autorités de la République populaire de Chine, épicentre de la pandémie, qui en ont nié l’existence, alors qu’elle n’en était encore qu’à l’état d’épidémie, du 17 novembre 2019 (date à laquelle un premier cas est signalé à Wuhan en Chine centrale) jusqu’au 20 janvier 2020, allant même jusqu’à arrêter début janvier pour « propagation de fausses nouvelles » le Dr Li Wenliang qui avait lancé l’alerte et qui décèdera victime du coronavirus le 7 février. Cf. https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/il-ne-faut-pas-diffuser-cette-information-au-public-l-echec-du-systeme-de-detection-chinois_6035704_3210.html mis en ligne le 6 avril 2020.
[3] Actuel Premier ministre libéral-conservateur des Pays-Bas.
[4] Actuel Premier ministre social-démocrate de la Suède.
[5] Au 15 avril 2020, Taïwan n’a ainsi enregistré que six morts sur une population de quelque vingt-quatre millions d’habitants. A la même date, la Corée du Sud compte deux cent vingt-deux morts pour quelque cinquante-et-un millions d’habitants.
[6] On trouvera un panel d’exemples pris dans de nombreux pays de telles pressions dans « Éphéméride sociale d’une épidémie », Covid-19 Un virus très politique, pages 37-81, https://www.syllepse.net/syllepse_images/articles/un-virus-tre–s-politique.pdf, 2e édition mise en ligne le 6 avril 2020.
[7] Ces injonctions contradictoires et la recherche de leur difficile (voire impossible) solution sont même au cœur de toute une réflexion d’économistes anxieusement penchés au chevet de l’économie capitaliste en berne ; cf. Michel Husson, « Sur l’inanité de la science économique officielle: de l’arbitrage entre activité économique et risques sanitaires », http://alencontre.org/economie/sur-linanite-de-la-science-economique-officielle-de-larbitrage-entre-activite-economique-et-risques-sanitaires.html mis en ligne le 14 avril 2020.
[8] Cf. « Introduction générale au devenir-monde du capitalisme », La préhistoire du capital, Lausanne, Page 2, 2006, pages 9-90, disponible en ligne http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/prehistoire_du_capital_t1/Prehistoire_du_capital_t1_Page2.pdf
[9] Cf. Kim Moody, « How “just-in-time” capitalism spread Covid-19. Trade roads, transmission, and international solidarity », https://spectrejournal.com/how-just-in-time-capitalism-spread-covid-19/, mis en ligne le 8 avril 2020.
[10] Y compris au sein de l’Union européenne, au sein de laquelle l’intégration des États-nations en un bloc continental d’États s’est avancée le plus loin, au point de servir d’exemple (sinon de modèle) à d’autres tentatives du même ordre : le Mercosur en Amérique latine, la CDEAO (la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest) ou encore l’Anase (Association des nations de l’Asie du Sud-est). Il suffit de voir comment l’Italie a été abandonnée à son sort (pendant des semaines, elle a reçu plus d’aide de la Chine, de la Russie et même de Cuba que des autres États membres de l’UE !) et les querelles de chiffonniers qui opposent aujourd’hui les États européens pour l’acquisition du matériel de base, par exemple les masques : cf. https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/requisition-et-indignation-partagee-la-guerre-des-masques-entre-la-suede-et-la-france_2122374.html mis en ligne le 1er avril 2020.
[11] Cf. Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », Le Monde diplomatique, mars 2020 ; et Serge Morand, « Alors que la biodiversité s’éteint progressivement, les maladies infectieuses et parasitaires continuent d’augmenter », http://alencontre.org/societe/covid-19-et-biodiversite-alors-que-la-biodiversite-seteint-progressivement-les-maladies-infectieuses-et-parasitaires-continuent-daugmenter.html mis en ligne le 18 mars 2020.
[12] En France, la Loi de finances rectificative votée par le Parlement mi-mars a porté cette garantie à la hauteur de 300 Mds €.
[13] Cf. Michel Husson, « Le grand bluff de la robotisation », http://alencontre.org/societe/le-grand-bluff-de-la-robotisation.html mis en ligne le 10 juin 2016 : repris dans http://hussonet.free.fr/robobluff.pdf.
[14] https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/22/coronavirus-ce-que-contient-le-projet-de-loi-urgence_6034040_823448.html mis en ligne le 23 mars 2020.
[15] En France : les 45 Mds € d’aides économiques et sociales sous forme de reports d’impôts et de cotisation sociales, de fonds de soutien au PME, de prise en charge partiel du régime de chômage technique, de maintien des indemnités de chômage échues en mars, etc., annoncés le 17 mars ont été portés à 100 Mds € le 9 avril.
[16] En France, la Loi de finances rectificative votée par le Parlement mi-mars a chiffré cette baisse à quelque 10,7 Mds €.
[17] En France, selon la Loi de finances rectificative votée par le Parlement mi-mars, le déficit budgétaire passerait ainsi en 2020 de 2,2% à 3,9% du Pib. Mais, dès le 10 avril, le déficit prévu est chiffré à 7,6 % du Pib (du jamais vu !), ce qui porterait la dette publique à 112 % du Pib : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-gerald-darmanin-et-bruno-le-maire-e-plan-durgence-revise-a-100-milliards-deuros-1193765 mis en ligne le 9 avril. Mais la vertueuse Allemagne ne fait pas mieux : le Bundestag a voté une rallonge budgétaire de 156 Mds €, représentant une hausse du budget fédéral de 43 % et portant le déficit budgétaire prévisible sur l’année à 4,3 % du Pib, pulvérisant du même coup le dogme de l’équilibre budgétaire pratiqué depuis cinq ans ; cf. https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-feu-vert-a-une-hausse-de-plus-de-40-du-budget-allemand-1189875 mis en ligne le 28 mars 2020.
[18] Le quantitive easing (assouplissement quantitatif) consiste en des opérations d’achat massif d’obligations (titres de crédit) d’États sur le marché boursier, ce qui a pour effet de faire baisser les taux auxquels les États peuvent accéder à de nouveaux prêts. La Banque centrale européenne (BCE) a ainsi annoncé qu’elle s’apprête à racheter des titres de dettes publiques pour un montant de 750 Mds € et la Fed (la Banque centrale états-unienne) pour un montant de 1500 Mds $. Ce n’est en somme qu’une nouvelle forme de la vieille pratique consistant à « faire fonctionner la planche à billets » : à émettre de la monnaie sans contrepartie de production de valeur, avec des risques évidents d’inflation.
[19] Seule a été envisagée la mise en œuvre du Mécanisme européen de stabilité (MES) dont l’activation est subordonnée à la mise en œuvre de politiques d’austérité budgétaire, alors que c’est tout le contraire qui devrait être à l’ordre du jour. Cf. Marco Parodi, « Le virus de l’Union européenne et le faux vaccin du comte Dracula », http://alencontre.org/europe/le-virus-de-lunion-europeenne-et-le-faux-vaccin-du-conte-draghula-1.html mis en ligne le 10 avril 2020.
[20] Cf. Laurent Mauduit et Martine Orange, « Hôpital public : la note explosive de la Caisse des dépôts », Médiapart, 1er avril 2020.
[21] Cf. https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/plan-economies-hopital-nancy-directeur-ars-grand-est-persiste-signe-je-fais-mon-boulot-1811946.html mis en ligne le 5 avril 2020. Ce directeur a été limogé le 8 mars.
[22] Cf. http://alencontre.org/suisse/suisse-covid-19-et-hopitaux-encore-un-effort-pour-garrotter-les-hopitaux-et-epuiser-les-soignant%c2%b7e%c2%b7s.html mis en ligne le 7 avril 2020.
[23] Cf. « Nos observations sur l’état d’urgence sanitaire », http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/note_e_tat_d_urgence_sanitaire.pdf mis en ligne le 23 mars 2020.
[24] Cf. à ce sujet l’article « Crise » dans La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, Page 2 & Syllepse, Lausanne & Paris, 2017.
[25] Une externalité négative est une nuisance ou dommage produit par un agent économique et dont celui-ci n’a pas à assumer le coût.
[26] Cf. Bruno Canard, « En délaissant la recherche fondamentale, on a perdu beaucoup de temps », L’Humanité, 19 mars 2020.
[27] Cf. https://oip.org/covid19-en-prison-lessentiel/ mis en ligne le 9 avril 2020.
[28] Cf. https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/03/covid-19-face-aux-risques-de-contamination-le-defenseur-des-droits-demande-la mis en ligne le 23 mars 2020.
[29] Cf. https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/la-psychiatrie-victime-collaterale-du-covid-19-1191330 mis en ligne le 2 avril 2020.
[30] Les exemples précédents sont empruntés au cas français. Mais les mêmes orientations peuvent se décliner dans les différents États en fonction des spécificités de leur système de prélèvements obligatoires.
[31] Ou continental, dans le cas de la formation d’un bloc d’États continental reprenant à son compte les orientations ici déclinées, par exemple dans le cadre de l’Union européenne.
[32] Car il n’est pas normal qu’un État (la France ou n’importe quel autre) soit devenu dépendant pour son approvisionnement en médicaments et en matériels de première nécessité de chaînes transnationales que son appareil sanitaire ne contrôle plus, avec pour conséquence de fréquentes pénuries, perceptibles bien avant l’actuelle pandémie. Cf. http://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200306-coronavirus-approvisionnement-m%C3%A9dicaments-remise-cause mis en ligne le 6 mars 2020.
[33] Cf. Alain Lipietz, Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, La Découverte, 2012 ; Naomi Klein, Tout peut changer : Capitalisme et changement climatique, Acte Sud, 2015 ; Naomi Klein, Plan B pour la planète ; le New Deal vert, Acte Sud, 2019. Pour une approche critique de cette thématique, cf. John Bellamy Foster, « Écologie. En feu, cette fois-ci », https://alencontre.org/ecologie/ecologie-en-feu-cette-fois-ci.html mis en ligne le 19 décembre 2019.
[34] Symptomatiquement, les deux candidats à l’investiture démocrate pour les prochaines élections présidentielles aux États -Unis qui se référaient sérieusement au Green New Deal, Bennie Sanders et Elizabeth Warren, ont été éliminés de la course.
[35] https://eelv.fr/le-covid-19-nous-impose-de-modifier-profondement-notre-rapport-au-vivant/ mis en ligne le 11 avril 2020.
[36] https://eelv.fr/audition-par-le-premier-ministre-la-transition-ecologique-dans-la-justice-sociale-voila-le-chemin-a-suivre-pour-la-sortie-de-crise/ mis en ligne le 11 avril 2020.
[37] La contribution de la Convention Citoyenne pour le Climat au plan de sortie de crise, https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/Contribution-de-la-CCC-au-plan-de-sortie-de-crise-1.pdf mis en ligne le 9 avril 2020.
[38] Cf. https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/lettre-ouverte-de-philippe-martinez-au-president-de-la mis en ligne le 7 avril 2020.
[39] https://www.youtube.com/watch?v=rKkUkUFbqmE
[40] Allocution du 12 mars 2020.
[41] http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-angela-merkel-appelle-l-europe-a-produire-ses-propres-masques-06-04-2020-8295051.php mis en ligne le 6 avril 2020.
[42] Cf. Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, La Découverte, 2012 ; et l’article « Capitalisme vert » dans La novlangue néolibérale, op.cit.
[43] Pour de nombreux exemples de tels mouvements un peu partout dans le monde, cf. là encore « Éphéméride sociale d’une épidémie », op.cit.
[44] Ce qu’est l’appareil de production capitaliste en dépit du fait qu’il repose sur la propriété privée des moyens de production. Ce double caractère, propriété privée + production sociale, fait d’ailleurs partie des contradictions fondamentales du procès immédiat de reproduction du capital.
[45] Il est vrai que la plupart de ces reconversions, pas toutes cependant, se sont produites à l’initiative des directions capitalistes, tant il est vrai que la valorisation du capital est indépendante de la nature des marchandises produites. Il n’est pas moins vrai qu’elles n’ont pu avoir lieu sans le savoir et le savoir-faire des travailleurs et travailleuses de la base, augurant ainsi de la capacité de pareilles reconversions sous leur direction.
[46] Les Amap (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) regroupent des petits producteurs agricoles et des consommateurs dans des circuits de distribution courts, dans le but de préserver et de développer une agriculture socialement équitablement et écologiquement saine et durable.
[47] Cf. l’appel « Covid-Entraide » reproduit dans Covid-19 un virus très politique, op. cit., pages 100-101.
[48] « Les satellites ont déjà mesuré les changements en Chine, où le suivi de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a monté que les émissions de dioxyde d’azote ont diminué de 30 % en février 2020 » http://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-22-millions-de-personnes-pourraient-mourir-aux-etats-unis-si-le-coronavirus-nest-pas-maitrise.html mis en ligne le 19 mars 2020.
[49] Cf. « Coronavirus : L’effet du confinement (et son impact sur la pollution en Europe) se voit aussi depuis l’espace » https://www.20minutes.fr/planete/2752615-20200401-coranavirus-effet-confinement-impact-pollution-europe-voit-aussi-depuis-espace mis en ligne le 1er avril 2020.
[50] Cf. « Coronavirus en Inde : L’Himalaya vu à 200 kilomètres de distance grâce… à la baisse de la pollution » https://www.20minutes.fr/planete/2758103-20200409-coronavirus-inde-himalaya-vu-200-kilometres-distance-grace-baisse-pollution mis en ligne le 9 avril 2020.
[51] Pour un inventaire plus détaillé, cf. « Pour une socialisation de l’appareil sanitaire », https://alencontre.org/europe/france/covid-19-pour-une-socialisation-de-lappareil-sanitaire.html mis en ligne le 18 mars 2020.
[52] Cf. des propositions plus détaillées dans Sam Gindin, « Perspectives socialistes : le coronavirus et la présente crise », http://alencontre.org/laune/etats-unis-et-au-dela-perspectives-socialistes-le-coronavirus-et-la-presente-crise.html mise en ligne le 13 avril 2020.
[53] Cf. à ce sujet l’article « Dette publique » dans La novlangue néolibérale, op.cit. C’est également la position défendue par François Chesnais : « l’occasion historique s’ouvre de faire pas seulement de la suspension du paiement des dettes publiques, mais de leur annulation, une revendication commune aux pays industriels avancés impérialistes et aux pays à statut économique colonial et semi-colonial. Il était inévitable que le poids des dettes publiques des pays avancés donne lieu, avec l’aggravation de la crise, à la question de leur légitimité et la nécessité de leur annulation/répudiation » http://alencontre.org/laune/letat-de-leconomie-mondiale-au-debut-de-la-grande-recession-covid-19-reperes-historiques-analyses-et-illustrations.html mis en ligne le 12 avril 2020.
Source https://www.contretemps.eu/covid-19-sorties-crise/